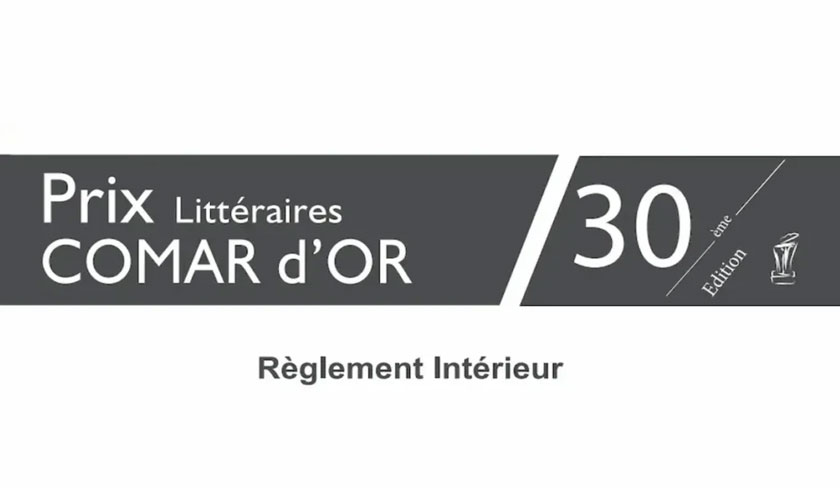Par Amin Ben Khaled *
« La Tunisie ne s’est jamais effondrée à Mezzouna par hasard : elle y est revenue, comme on retourne à une vieille blessure que l’histoire refuse de cicatriser.»
La Tunisie, souvent louée pour l’unicité de son territoire dans la Méditerranée Sud, révèle au-delà des apparences une histoire façonnée par une déchirure ontologique profonde. Cette fracture, souvent ignorée sous le vernis d’une unité territoriale apparemment immuable, se manifeste à travers deux espaces symboliques aux caractéristiques contradictoires. Mais c’est avec le fracas du mur de Mezzouna – ce cri sourd d’un pays qui s’effrite – que cet article prend son essor, pour explorer cette dualité, son évolution historique et les conséquences politiques qui en découlent.
I. L’héritage d’une dualité territoriale
Une unité apparente, une dualité sous-jacente
La Tunisie a su, au fil des siècles, maintenir une continuité territoriale remarquable. Qu’il s’agisse des périodes d’expansion ou des morcellements épisodiques, le territoire tunisien reste globalement identique. Pourtant, cette permanence repose sur une dualité intrinsèque : d’un côté, le littoral phénico-carthaginois, et de l’autre, l’intérieur berbéro-numide.
Le littoral phénico-carthaginois : mercantilisme et pragmatisme
Cet espace, façonné par une histoire de commerce et d’ouverture vers le monde méditerranéen, se caractérise par une dynamique mercantile. Sa principale force réside dans le pragmatisme et la capacité d’adaptation aux exigences économiques du moment. Cependant, l’ombre de ce pragmatisme se traduit par un vice : la tentation de pactiser avec des intérêts immédiats, parfois aux dépens d’un projet de développement à long terme. Ce compromis constant entre profit immédiat et ambition durable peut être comparé, dans sa forme la plus extrême, à un pacte avec un « diable » symbolique qui corrompt les structures mêmes de la société.
L’intérieur berbéro-numide : protectionnisme et conservatisme
En contraste, l’intérieur tunisien, ancré dans une tradition berbère et numide, privilégie un modèle protectionniste où l’accent est mis sur la préservation des valeurs locales. Ce conservatisme, source de fierté identitaire, comporte néanmoins le risque de s’enfermer dans des logiques d’autoprotection qui, à trop vouloir préserver l’existant, peuvent empêcher toute adaptation aux changements nécessaires. Là encore, l’inévitable pacte avec ce « diable » de la stagnation menace de paralyser le dynamisme de l’ensemble du territoire.
II. Bourguiba : L’État régulateur face à la dualité
L’héritage historique et la construction d’un État régulateur
Si l’État tunisien, en tant que structure formelle centralisée, est une continuité issue des Hafsides aux Mouradites puis aux Husseinites, c’est sous Bourguiba que la notion d’État régulateur prend forme. Bourguiba n’a pas créé la nation tunisienne, mais il a entrepris de transcender la fracture initiale en promouvant un projet social ambitieux. Il a tenté de rapprocher l’État des réalités locales, en mettant sur pied un « ascenseur social » permettant à des individus issus de divers horizons de participer au projet national.
Les limites du modèle bourguibien
Cependant, malgré ces efforts, le projet bourguibien n’a pas permis une régulation parfaite de la dualité qui traverse la Tunisie. La capitale et le Sahel, héritiers d’un pragmatisme phénico-carthaginois, en ont bénéficié davantage que l’intérieur berbéro-numide. Ce déséquilibre manifeste, même s’il a offert des perspectives d’ascension sociale, a également creusé un fossé entre deux visions incompatibles de la société tunisienne.
III. Ben Ali et l’État monstre
L’État au bord du gouffre démocratique
Avec l’avènement de Ben Ali, un nouvel épisode s’est inscrit dans cette longue lutte entre deux espaces antagonistes. Héritier d’un État qui avait manqué l’opportunité de s’enraciner dans la démocratie, Ben Ali a opté pour une centralisation du pouvoir qui allait accentuer les déséquilibres. Sa vision « auto-centrée » du pouvoir et son identification quasi exclusive avec les valeurs du Sahel ont créé une dynamique dans laquelle l’État devenait un monstre mercantiliste, déconnecté des aspirations de l’intérieur.
La dérive autoritaire et les vices structurels
L’État de Ben Ali, par ses pratiques oppressives, a essayé de contrôler l’espace de l’intérieur via une bureaucratie lourde et répressive. Ce faisant, il a nourri un double vice : d’un côté, l’excès mercantiliste qui alimente une logique de profit à court terme, et de l’autre, un protectionnisme local qui voit en l’État un intrus perfide et indifférent aux réalités locales. Cette dualité, jamais réellement apaisée, prépare le terrain pour une explosion de tensions qui se manifestera plus tard dans la sphère révolutionnaire.
IV. La révolution : l’éclatement de la déchirure
Une double révolution, deux espaces en lutte
La révolution tunisienne, vécue à travers des dates emblématiques – celle du 17 décembre et celle du 14 janvier – reflète cette fracture intrinsèque. D’un côté, la révolution dite du 17 décembre incarne l’exigence de l’intérieur berbéro-numide, appelant à une rupture radicale et un jusqu’au-boutisme face aux inégalités. De l’autre, celle du 14 janvier témoigne d’un pragmatisme propre au littoral, où l’idée d’un renouveau passe par une reformulation des structures étatiques.
La Constituante, symbole ambigu d’un compromis difficile
Face à cette double révolution, l’effort de rassembler la nation se matérialisa par la création d’une Assemblée Constituante et l’élaboration d’un texte fondamental. Ce document, censé servir de tiers régulateur, se révèle équivoque. Sur le plan formel, il rassemble, mais sur le fond, il souffre d’une « flouité » qui ne parvient qu’à masquer temporairement une déchirure profonde entre deux visions du devenir tunisien. Le régime politique ainsi formé peine à concilier les exigences de liberté publique avec la réalité d’un État encore déchiré.
V. Les enjeux de la rhétorique populiste et les conséquences futures
La montée du populisme face à un texte déchiré
Le vide laissé par l’absence d’un tiers régulateur solide a ouvert la porte à la rhétorique populiste. Dans ce contexte, deux tendances s’affrontent : d’un côté, celle qui appelle à un retour au méta-texte, avec le Coran comme référence ultime ; de l’autre, celle qui rejette tout texte fixe, préférant des accords contractuels et fluctuants en fonction des intérêts immédiats. La première tendance, favorisée par certains islamistes, se heurte aux intérêts pragmatiques d’un espace phénico-carthaginois en quête de renouveau.
La perspective d’un chaos inévitable
Sans l’intervention d’un tiers régulateur capable d’harmoniser ces tensions, la déchirure originelle risque de déboucher sur un chaos profond. Une séparation extrême entre les deux espaces pourrait conduire, à terme, à des conflits ouverts, voire à une guerre civile. Dans cet état de déséquilibre, chaque espace serait tenté de pactiser avec son « diable » – l’un sombrant dans un mercantilisme débridé, l’autre dans un conservatisme dévastateur. La possible émergence d’un État théologique à l’iranienne ou d’un État mafieux à la colombienne apparaît ainsi comme une solution alternative, mais ô combien périlleuse.
L’équilibre entre l’individu et la collectivité
Au cœur de ce tumulte, la véritable réponse résiderait dans la responsabilisation de l’individu, cette cellule fondamentale de la société. Le synthétiseur de l’antinomie, l’individu conscient de ses propres contradictions, est celui qui pourrait réconcilier des visions opposées. La mission éthique qui incombe à tout homme politique intègre serait de promouvoir une éducation permettant à chacun de gérer ces dualités, afin de rétablir un équilibre subtil entre la Tunisie de l’intérieur et celle du littoral.
VI. Vers une Tunisie régulatrice et équilibrée
L’histoire de la Tunisie, telle que nous l’avons parcourue, est marquée par une tension permanente entre deux espaces symboliques, chacun porteur d’une réalité socio-économique et culturelle distincte. La déchirure originelle, héritée de cette dualité entre le pragmatisme mercantiliste du littoral et le conservatisme protectionniste de l’intérieur, a traversé les âges et s’est retrouvée exacerbée par des régimes autoritaires et des processus révolutionnaires inachevés.
La période bourguibienne représente une tentative courageuse, quoique imparfaite, de réunir ces espaces sous l’égide d’un État régulateur – une structure qui, par son ascenseur social, a offert une ouverture vers une synthèse collective. À l’inverse, l’ère de Ben Ali a accentué la divergence par une centralisation du pouvoir qui nourrissait les tensions plutôt que de les atténuer.
La révolution tunisienne est ainsi le point d’orgue de cette lutte entre deux mondes. Si les constitutions successives se révèlent équivoques, c’est peut-être le reflet même de la complexité d’une société qui oscille entre visions antinomiques. Pour éviter le chaos imminent d’un découplage extrême – qui pourrait déraper vers des conflits internes voire une fragmentation territoriale – l’avenir de la Tunisie semble dépendre de sa capacité à responsabiliser l’individu et à instaurer un tiers régulateur véritablement porteur d’une synthèse des deux profondeurs.
En définitive, la quête d’une Tunisie équilibrée passe par une éducation qui permette à chacun de gérer ses contradictions et de contribuer, en tant qu’acteur libre et conscient, à la construction d’un avenir commun. Le défi n’est pas seulement politique ou économique, il est aussi profondément anthropologique : réconcilier la déchirure originelle avec la force unificatrice du vivre ensemble.
Postulude : Le mur de Mezzouna, symbole d’une Tunisie à reconstruire
L’effondrement du mur de Mezzouna n’est pas qu’un accident tragique ; c’est la métaphore d’un État fissuré, dont les fondations peinent à contenir les tensions accumulées entre deux Tunisies irréconciliées. Ce drame, survenu dans l’indifférence relative des centres de pouvoir, rappelle cruellement que les fractures territoriales et sociales, si longtemps ignorées, finissent toujours par se rappeler à nous, parfois dans le fracas du béton, souvent dans celui des révoltes.
La Tunisie post-révolutionnaire, tiraillée entre héritages contradictoires et populismes opportunistes, doit choisir : continuer à masquer ses déchirures don-quichottesques, ou entreprendre la difficile reconstruction d’un pacte national inclusif. Un pacte où la capitale ne dicterait plus sa loi à l’intérieur, où l’État ne serait plus perçu comme un monstre lointain ou un justicier capricieux, mais comme le régulateur impartial d’une diversité assumée.
Hommage aux victimes de Mezzouna : mémoire et exigence
Aux vies fauchées ce jour-là, à ces visages anonymes qui symbolisent les laissés-pour-compte d’une Tunisie à deux vitesses, nous devons plus que des condoléances. Nous leur devons la mémoire active de leur tragédie, transformée en exigence politique. Que leur mort ne soit pas vaine, mais un rappel brutal : un pays qui laisse ses murs s’effriter, ses périphéries se désagréger et ses citoyens s’enfermer dans des antagonismes stériles, est un pays qui court à sa perte.
Mezzouna, comme Sidi Bouzid avant elle, nous crie que l’unité tunisienne ne se décrète pas – elle se construit. Sur les ruines de ce mur, bâtissons non pas un nouveau rempart, mais des ponts. Des ponts entre les héritages phéniciens et numides, entre le pragmatisme et la préservation, entre l’individu et la collectivité. C’est seulement ainsi que la Tunisie évitera le pire : devenir, comme tant d’autres, une terre où les murs qui tombent ne révèlent que l’abîme.
*Avocat et ancien diplomate