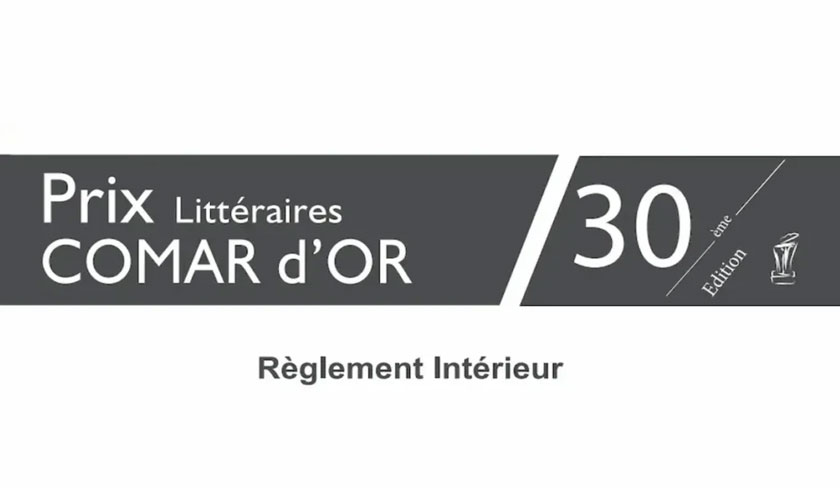Par Mohamed Salah Ben Ammar*
Le 9 octobre 2025, un cessez-le-feu a été signé à Gaza après deux années d’une guerre totale. Le mot “paix” refait surface, mais sur un champ de ruines. Israël parle de sécurité retrouvée, le monde de reconstruction, alors qu’un peuple entier lutte encore pour exister.
733 jours, 1 heure, 54 minutes et 16 secondes. C’est le temps qu’il aura fallu pour que le mot paix réapparaisse dans les communiqués officiels. Deux années de destruction, de désespoir, de silence, de lâcheté et de compromission. Ce 9 octobre 2025, un cessez-le-feu a été signé, sous l’impulsion inattendue de Donald Trump, revenu sur la scène diplomatique pour contraindre le gouvernement d’extrême-droite israélien à mettre fin à ses opérations. Son gendre Jared Kushner et son émissaire Steve Wittock — deux sionistes notoires et pas des colombes — ont conduit la délégation américaine. Que vaut cette paix imposée par un arbitre partial pour ne pas dire clairement ennemi ?
Une guerre d’anéantissement
Le bilan humain dépasse l’imaginable : plus de 66.000 Palestiniens tués, 170.000 blessés, dont une majorité d’enfants, selon les estimations jugées fiables par les Nations unies. Côté israélien, 460 soldats ont perdu la vie, près de 3000 ont été blessés, la plupart très jeunes.
Ces chiffres masquent ce que les images, interdites pendant des mois, révèlent aujourd’hui : une bande de Gaza méthodiquement détruite, de la frontière du kibboutz Beeri jusqu’à la mer Méditerranée. Les quartiers sont devenus des terrains vagues, les mosquées des amas de béton, les écoles des cratères. 97 % des établissements scolaires ont été endommagés ou détruits, 78 % des immeubles, 88 % des commerces, 77 % des routes.
La ville n’est plus qu’une mosaïque de gravats. L’ONU parle de 61 millions de tonnes de débris, dont une partie contaminée par des métaux lourds. Même la nature a disparu : plus d’arbres, plus d’animaux, plus d’eau potable. Gaza est devenue un lieu où la vie elle-même a été déprogrammée.
Une enclave fantôme
Lorsque l’armée israélienne a autorisé, le 3 octobre, une quinzaine de médias internationaux à pénétrer dans Gaza, le spectacle était celui d’une disparition. Des quartiers entiers vidés, des chiens errants, des corbeaux posés sur des chars. Plus d’habitants. Un no man’s land au sens littéral.
Les témoignages recueillis sur place décrivent une enclave effacée de la carte humaine : 82 % du territoire est aujourd’hui sous contrôle israélien ou interdit d’accès aux Palestiniens, sous peine de mort. Plus de 800.000 personnes ont fui la ville de Gaza. 1,5 million de déplacés vivent dans des abris de fortune, souvent sans nourriture. Certains — et ils sont nombreux — ont été déplacés jusqu’à dix fois.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Médecins sans frontières (MSF) ont dû suspendre leurs activités en raison de l’insécurité absolue. Près de 2000 agents de santé ont été tués. L’aide humanitaire est fragmentée, les corridors à peine fonctionnels.
Et pourtant, on parle déjà de reconstruction. Jared Kushner et les grandes entreprises de bétonneurs occidentales se frottent les mains.
La paix des vainqueurs et des vaincus
Les autorités israéliennes célèbrent un retour à la sécurité. Le Hamas, affaibli, parle de résistance intacte. La communauté internationale, elle, se félicite, hypocritement, d’un cessez-le-feu obtenu après tant d’échecs diplomatiques et six vetos américains au Conseil de sécurité. Mais la paix qui s’annonce n’a pas de visage humain. Elle ressemble à une reddition imposée à un peuple épuisé.
Gaza est désormais placée sous protectorat international. C’est peut-être préférable à l’occupation israélienne, mais cela ne répare rien. Le mot reconstruction revient dans les discours. Mais comment reconstruire quand il ne reste plus de fondations ? Quand 15 % des débris sont contaminés, quand les nappes phréatiques sont toxiques, quand l’environnement lui-même est devenu un danger ?
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement alertait déjà, le 23 septembre, sur une pollution susceptible d’affecter « la santé des habitants de Gaza sur plusieurs générations ».
Cette guerre n’avait pas pour but de détruire la terre, mais la mémoire d’un peuple, une mémoire de 5000 ans.
Les enfants n’ont plus d’école. Les familles n’ont plus de maison. Les diabétiques, les insuffisants rénaux, les palestiniens porteurs de maladies chroniques sont morts pour la plupart. Les morts n’ont plus de tombe. Et le monde, fatigué, parle de paix comme on parlerait d’un épilogue.
Une paix sans vérité
Israël n’a jamais accepté l’existence même du peuple palestinien. Depuis soixante-dix-sept ans, tout a été fait pour nier son histoire, effacer sa présence, effondrer son récit. Coloniser, fragmenter, rebaptiser : autant de manières d’imposer l’idée que les Palestiniens ne sont qu’une parenthèse de l’Histoire.
Alors pourquoi, aujourd’hui, ce même Israël changerait-il d’avis ? Tout, dans ce cessez-le-feu du 9 octobre, plaide en faveur d’une manœuvre diplomatique plus qu’un tournant moral. Il fallait libérer les derniers otages, calmer la pression internationale, desserrer l’étau d’une opinion mondiale choquée par l’ampleur du carnage.
La paix, ici, ressemble à une opération de communication — un répit utile, non une reconnaissance sincère. Le vain espoir d’un prix Nobel de la paix ?
Car reconnaître la Palestine, ce n’est pas seulement admettre l’existence d’un État ; c’est démentir tout le discours fondateur d’Israël, celui d’une terre « sans peuple pour un peuple sans terre ».
Accepter la Palestine, c’est admettre qu’il y a eu dépossession, occupation, apartheid. C’est reconnaître que la sécurité d’un peuple ne peut pas se construire sur la disparition d’un autre.
Et cela, Israël n’y est pas prêt. Pas encore. Peut-être jamais.
La sincérité israélienne est hautement douteuse, non par cynisme politique, mais parce qu’elle supposerait un basculement moral que l’histoire de ce conflit n’a jamais connu : celui de la reconnaissance de l’autre. Depuis 1948, tout, absolument tout, vise à empêcher cette reconnaissance — des expulsions de la Nakba aux bombardements de 2025.
Mémoire ou oubli
Ce 9 octobre, les armes se taisent. Mais il ne s’agit pas d’une paix : seulement d’un épuisement partagé, d’un silence probablement temporaire obtenu sous la contrainte.
Une paix sans vérité n’est qu’une trêve entre deux effacements.
Les Palestiniens n’ont pas seulement perdu leurs maisons : ils ont perdu le droit d’exister dans le regard du monde. Et cette perte-là, aucun accord ne peut la compenser.
Car on ne négocie pas la dignité d’un peuple : on la lui restitue, ou on la nie encore.
Le monde, lui, se félicite. Il parle de « paix historique », d’« espoir », de « nouveau départ ».
Mais à Gaza, dans les camps du sud, au milieu des gravats et des eaux polluées, un peuple regarde le ciel et se demande s’il a encore une place sur cette terre.
La vérité, c’est qu’il n’y a pas de paix possible tant que l’existence palestinienne demeurera un scandale aux yeux d’Israël.
Et tant que cette vérité ne sera pas dite, la guerre, elle, continuera — dans les mémoires, dans les ruines, dans les consciences.
On ne fait pas la paix sur des ruines.
On ne fait pas la paix en niant l’existence de ceux qu’on a voulu effacer.
On ne fait pas la paix sans vérité.
* Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD – MBA