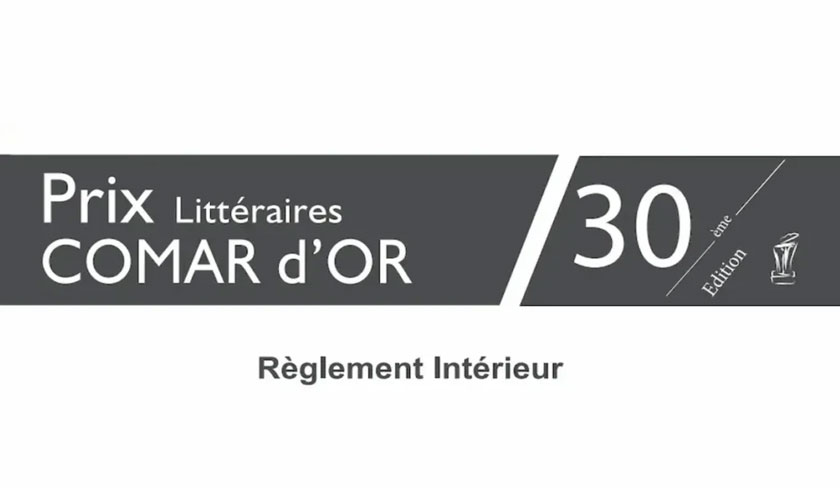Par Mohamed Salah Ben Ammar*
Révolution, Patriotisme, Solidarité, Probité…
Des mots qui ne veulent plus rien dire de nos jours. Ou plutôt : des mots qui veulent tout dire et donc plus rien.
La Tunisie s’épuise à réciter son vocabulaire comme un chapelet de promesses creuses.
Les discours du pouvoir et de l’opposition flottent dans l’air, sans lien, sans ancrage, comme des drapeaux sans vent.
Le pays semble parler sans s’écouter, s’adresser à lui-même dans une langue qu’il ne comprend plus.
Le langage vidé de sens
Chaque crise apporte son lot de slogans. Ceux de la haine l’emportent de nos jours : « le peuple veut », « la lutte contre la corruption », « la souveraineté nationale », « l’épuration de la nation » « corruption », « nationalisme », « traîtres », « ennemis du peuple »…
Heureusement qu’à force d’être invoqués, ces mots ne désignent plus rien.
La révolution est célébrée mais désincarnée, la corruption dénoncée mais jamais éradiquée, le nationalisme, notion détestable s’il en est, invoqué pour masquer l’impuissance, la probité transformée en posture morale.
Les traîtres sont partout et nulle part, désignés selon les besoins du moment ; et le peuple, tout le monde en parle mais personne n’arrive à le définir avec précision, tantôt sacralisé, tantôt infantilisé, ne sait plus à qui il appartient.
Ainsi, le langage politique tunisien ne sert plus à penser, mais à occuper le vide. Il remplace la réalité par son simulacre. On ne gouverne plus par le sens, mais par les mots.
Freud et la Tunisie : Éros contre Thanatos
Freud écrivait dans Malaise dans la civilisation (1930) que toute culture repose sur une tension fragile entre Éros, la pulsion de vie qui lie, et Thanatos, la pulsion de mort qui défait.
La Tunisie d’aujourd’hui semble avoir basculé du côté de Thanatos : le lien est rompu, la parole divisée, le commun fissuré. Le scatologique l’emporte sur l’espoir et la société vacille.
Le pouvoir parle au nom d’un « peuple », mais sans lui ; il prononce le mot démocratie tout en dissolvant les institutions qui en garantissent la forme.
Les mots ne sont plus des médiateurs du réel, mais des masques de sa négation.
Sous prétexte d’unité, on cultive la peur ; sous couvert de probité, on pratique la suspicion. Le langage, jadis espace du commun, devient arme d’exclusion.
Le langage détourné : de l’outil au leurre
En Tunisie, le mot révolution sert désormais à légitimer l’immobilisme ;
corruption devient un épouvantail politique pour régler des comptes ;
probité une performance morale ;
nationalisme un déguisement de la peur, qu’on confond avec patriotisme
et on développe un ethnocentrisme destructeur.
Le pouvoir n’a plus besoin de censure : il parle à la place des mots eux-mêmes, jusqu’à les épuiser.
Le langage cesse d’être un espace de sens pour devenir un théâtre de persuasion, où les mots séduisent sans éclairer.
Le terme ennemi a, lui, retrouvé une vitalité inquiétante incarnée par les adversaires politiques.
Traitres, vermines, des qualificatifs qui ne choquent plus.
Épuration et éradication sont employés pour désigner des opposants.
Chaque voix discordante devient une menace, chaque critique, une traitrise.
Le débat n’existe plus, remplacé par l’insulte.
Et dans ce vacarme, la vérité ne disparaît pas — elle devient inaudible.
Le vide comme violence
Cette crise du langage est une forme de violence symbolique : silencieuse, mais corrosive.
Elle fragilise le lien social, installe la méfiance, érode le sentiment d’appartenance.
Le vide ne se contente pas d’être absence de sens : il devient un mode de gouvernement.
Les institutions se figent, la parole publique se répète, et le peuple, saturé de mots, se détourne du réel.
Dans cette Tunisie du discours perpétuel, on parle pour ne pas agir, on promet pour ne pas répondre.
La violence du vide est plus redoutable que celle des armes : elle tue l’espérance de l’intérieur.
Résister par la parole
Et pourtant, tout n’est pas perdu.
Cynthia Fleury rappelle qu’il faut bâtir une clinique de la dignité : recréer des lieux où la parole soigne au lieu d’exclure, où elle relie au lieu de diviser.
Résister, aujourd’hui, ce n’est pas crier plus fort que les autres, mais parler plus juste.
C’est retrouver la clarté du mot juste face au vacarme du verbe politique.
C’est redonner à la parole sa fonction de soin et de vérité, et non d’intimidation.
La révolution tunisienne n’a pas échoué : elle a été momentanément confisquée par le langage.
La reprendre, c’est réapprendre à nommer, à dire sans mentir, à parler sans manipuler.
Pour une reconquête du sens
Révolution, Patriotisme, Solidarité, Probité…
Ces mots, s’ils retrouvent leur poids, peuvent encore fonder un avenir commun.
Mais s’ils restent creux, ils deviendront les pierres tombales de notre démocratie.
Il ne s’agit plus seulement de politique, mais de civilisation : car une société ne meurt pas quand ses institutions s’effondrent, mais quand son langage se vide.
Tant qu’un mot pourra encore être prononcé pour relier et non pour dominer, tout ne sera pas perdu.
La Tunisie peut encore se réinventer — à condition de retrouver le sens des mots qu’elle prononce.
* Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD – MBA