Par Hichem Snoussi*
Le 25 juillet 2021 a marqué un tournant décisif dans le parcours de la révolution tunisienne. Il a inauguré une nouvelle phase de crise politique, profonde, qui a paralysé les services publics et plongé le pays dans une spirale d’instabilité institutionnelle et sociale.
Les développements ultérieurs ont révélé la limite du discours du pouvoir pour proposer des solutions réalistes aux enjeux sociaux et économiques, et confirmé que la démocratie n’est ni une priorité du président Kaïs Saïed ni intégrée à sa vision de l’avenir de l’État.
En parallèle, l’opposition a tenté de se restructurer à travers des initiatives présentées comme réformatrices. Mais elle a échoué à élaborer un discours véritablement nouveau, capable de rompre avec le passé : elle reste prisonnière de formulations rétrospectives qui reproduisent l’ancien système sans examen critique des causes de l’échec de la transition démocratique.
On peut même dire qu’une partie de l’opposition refuse toute approche critique sérieuse de la période pré-révolutionnaire, comme si l’histoire ne commençait qu’en 2011.
Ainsi, la compréhension des racines profondes de la crise est occultée, et l’autoévaluation est remplacée par la peur de la responsabilité, de peur que les masques tombent et que les responsabilités dans l’échec collectif soient exposées.
La structure du discours des initiatives « réforme et sauvetage »
La plupart des initiatives post-25 juillet s’appuient sur des « capsules » toutes faites : souveraineté nationale, refus de la dépendance à l’étranger, achever la transition démocratique…
Ce sont des slogans exploités dans ce que l’on pourrait appeler un « discours de sauvetage » : un discours qui se présente comme une alternative morale au système en place, sans disposer d’outils intellectuels ou pratiques pour le changement.
Des termes comme dialogue, sauvetage, démocratie deviennent des titres vides, destinés davantage à se positionner dans l’arène politique qu’à répondre aux besoins de la société.
Ce discours met en avant le concept de « nation », au détriment du concept de « citoyen ».
La nation est présentée comme un symbole vague pour justifier des positions, tandis que le citoyen, en tant qu’être concret ayant des intérêts et des questions réelles concernant ses libertés et ses droits sociaux, est absent.
Même si le mot « nation » est répété dans ces discours, il est utilisé dans un sens abstrait et quasi sacralisé, et non dans sa dimension civique fondée sur les droits tels que définis par les chartes internationales.
On n’y parle ni d’égalité de genre, ni de droits individuels, ni de justice sociale ou environnementale.
L’accent mis sur la souveraineté politique au sens central, sans l’étendre à la souveraineté du citoyen sur son propre destin, rend le discours prisonnier d’une conception hiérarchique traditionnelle de l’État, au détriment de la société.
Ainsi, le citoyen, acteur et source de légitimité, est remplacé par la « nation », un symbole purement rhétorique.
La nation devient le masque porté par le politique, tandis que le citoyen reste la mémoire vivante et la réalité tangible qui peut être tenue pour responsable.
Le discours de sauvetage apparaît donc déconnecté du réel, flottant dans l’espace des slogans au lieu de répondre aux questions essentielles que se posent les citoyens :
- Que nous avez-vous fait ?
- Mais surtout, que faites-vous pour vous-mêmes ?
- Et avant toutes ces promesses futures, comment peut-on reconstruire la confiance avec des acteurs qui n’ont jamais été dignes de celle-ci ?
Ignorer ces questions relève d’une manipulation politique et d’un refus de reconnaître ses erreurs, reproduisant ainsi l’absurdité du passé.
Une partie de l’opposition semble même puiser dans le vocabulaire du pouvoir : corruption, souveraineté, décision nationale, purification du climat politique.
Cela révèle une complicité symbolique entre les deux camps dans la manière dont ils représentent la crise et ses solutions.
Autrement dit, l’opposition conteste le système dans sa propre langue, plutôt qu’en dehors de celle-ci, ce qui la rend incapable de produire une rupture intellectuelle avec la logique politique dominante.
L’absence d’auto-évaluation historique : un dysfonctionnement structurel ou une fuite de la reconnaissance
La plupart des initiatives de sortie de crise ignorent l’examen du contrat de la transition démocratique (2011–2021) qui a conduit à l’impasse.
Aucune évaluation sérieuse des performances des partis, aucun compte rendu de la dépendance à l’étranger, ni analyse de l’expérience du « consensus » qui a vidé la démocratie de sa dimension délibérative.
La déconstruction critique des relations ambiguës entre religieux et politique, et de la confusion qui en découle sur la définition et la fonction de l’État, fait également défaut.
Dans ce sens, les discours de sauvetage traitent la crise comme un événement ponctuel et non comme le résultat d’un long processus social.
Ce saut par-dessus la dimension temporelle prive le discours de sa profondeur sociologique et transforme le sauvetage en slogan sans mémoire, c’est-à-dire en tentative de renouveler la légitimité sans renouveler la pensée.
Le discours de sauvetage devient alors un simple mécanisme linguistique, et non un projet de réforme réel.
Une lecture croisée de ces discours montre que la crise tunisienne n’est plus seulement une crise de textes ou d’institutions, mais une crise de crédibilité, de courage intellectuel et d’imagination politique, qui ne peut se résoudre qu’en ancrant la dimension délibérative de la démocratie.
Le discours de sauvetage tel que nous le voyons aujourd’hui est boiteux : il tente de contenir une réalité en mutation avec des outils d’interprétation dépassés, devenant un obstacle à la compréhension plutôt qu’un moyen d’action.
Ainsi, opposition et pouvoir apparaissent comme les deux faces d’une imagination politique figée, qui redoute l’avenir et reproduit le passé sous forme de projet.
Et le reproche ne doit pas se limiter au pouvoir : il concerne aussi ceux qui ont cru possible de construire une démocratie avec des outils intellectuels incapables de saisir leur temps et des personnalités dépourvues du courage de se regarder dans le miroir.
- Hichem Snoussi – Journaliste, ancien membre de la Haica









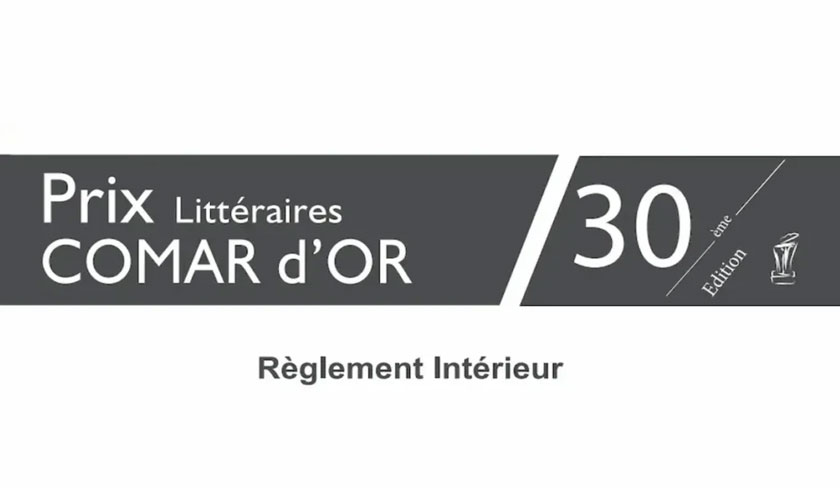



Commentaire
zaghouan2040
Trop simple
Vous faites semblant d’ignorer que nous vivons dans une dictature une véritable prison a ciel ouvert ou tout est surveillé suivi à la trace et réprimé
Les conditions fondamentales pour la proposition d’une initiative politique globale n’existent pas