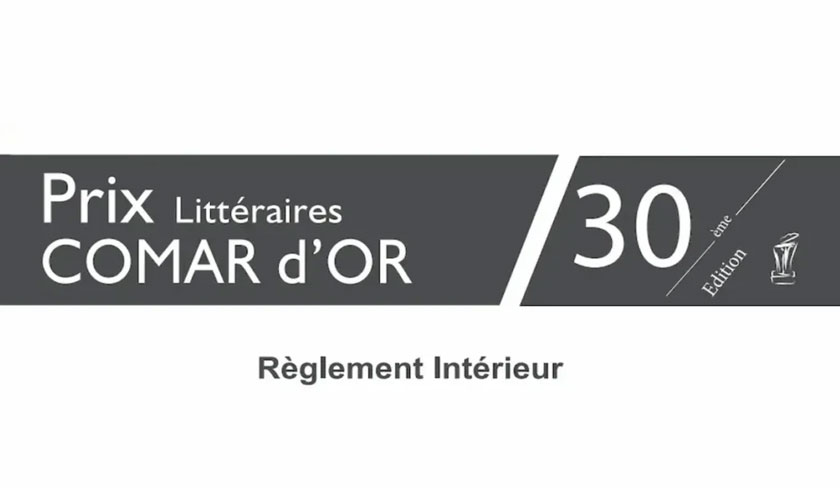Par Amin Ben Khaled*
Le 24 octobre 2025, le monde célèbre le 80e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. L’organisation, née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, incarne une ambition humaine sans précédent : éteindre les feux de la guerre, consacrer l’État de droit et préserver la dignité humaine face aux instincts destructeurs. Toutefois, la solennité de l’occasion se mêle aujourd’hui à un profond sentiment d’épuisement collectif et à une question douloureuse : que reste-t-il du rêve fondateur après huit décennies d’existence ?
Une réalité qui contredit le rêve
La planète traverse aujourd’hui une période de turbulences sans précédent, où les principes sur lesquels repose la Charte sont relégués en marge, comme si l’ordre international perdait peu à peu sa boussole morale. À Gaza, en Ukraine, au Soudan, au Yémen, en République démocratique du Congo et ailleurs, les guerres se succèdent et la justice recule sous le poids des doubles standards et du silence des grandes puissances. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité demeure prisonnier d’une paralysie chronique imposée par l’enchevêtrement des intérêts et le droit de veto que les grandes puissances utilisent comme bouclier pour protéger leur influence. Ainsi, la diplomatie du compromis s’est transformée en diplomatie de la force, tandis que les équilibres d’hier se sont dissous dans un monde complexe marqué par les rivalités et la confusion.
La fracture du multilatéralisme
Cette fracture n’est pas apparue ex nihilo. Depuis que les vents du repli nationaliste ont commencé à s’infiltrer dans les rangs des puissances fondatrices de l’ordre multilatéral, ce dernier a progressivement perdu son équilibre. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017 a constitué un tournant brutal : retraits successifs d’accords internationaux, remise en question des organisations mondiales et retour brutal à la logique des rapports de force. Néanmoins, les racines de la crise sont bien plus profondes.
En effet, la structure du Conseil de sécurité, figée depuis 1945, ne reflète plus la réalité du monde actuel. Cinq membres permanents — les vainqueurs d’une guerre achevée depuis huit décennies — conservent le droit de veto qui paralyse généralement toute action concrète. Le paradoxe douloureux réside dans le fait que chaque fois que l’un d’entre eux s’engage dans un conflit armé, l’organisation se retrouve paralysée : la Russie bloque les résolutions sur l’Ukraine, les États-Unis – alliés principaux d’Israël – font de même concernant Gaza. Ainsi, l’ONU, créée pour protéger la paix, se transforme en témoin silencieux de sa désintégration.
L’ONU : miroir des fractures du monde
Pour autant, juger l’ONU comme un échec total relève d’une simplification abusive. L’organisation ne produit pas les dysfonctionnements du monde, elle les reflète tels qu’ils sont. Elle est le miroir d’un ordre international où les souverainetés priment sur les règles et les intérêts stratégiques sur les principes. Si l’ONU semble impuissante, c’est parce qu’elle révèle, sans fard, la nature de la géopolitique contemporaine : un théâtre d’équilibres fragiles, d’intérêts enchevêtrés et d’alliances temporaires qui évoluent au gré des vents.
Dans cette faiblesse apparente réside sa force cachée : elle constitue l’unique espace où les contradictions du monde sont exposées publiquement. Elle démontre que le droit et la force coexistent sans se réconcilier, et que la paix n’est pas un état permanent, mais un parcours fragile qui oscille entre la logique de domination et l’espoir de justice.
Une institution invisible et indispensable
Loin des projecteurs et des gros titres, l’ONU continue d’assurer des fonctions vitales qui touchent la vie de millions de personnes. Son système humanitaire — du Programme alimentaire mondial au Haut-commissariat pour les réfugiés, en passant par l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé — constitue un filet de sécurité international qui soutient les déplacés, les affamés et les victimes de catastrophes. Quant aux missions de maintien de la paix, malgré leurs limites, elles demeurent la seule présence internationale dans des régions oubliées du monde.
Par ailleurs, l’organisation a contribué à construire un cadre normatif universel devenu partie intégrante de la conscience mondiale : la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conventions relatives aux réfugiés, les accords sur le climat, le désarmement et la non-prolifération nucléaire. En 2015, elle a lancé les Objectifs de développement durable qui sont devenus une boussole pour les politiques mondiales, même si les États peinent à les atteindre.
Bien que la Cour pénale internationale soit juridiquement indépendante, elle appartient en substance au même esprit de la Charte onusienne : une tentative continue de soumettre la force à la logique du droit. Ainsi, malgré ses difficultés, l’ONU reste un espace de médiation, de régulation et d’espoir, à une époque où les égoïsmes nationaux l’emportent sur la solidarité humaine.
Un monde nouveau, des institutions anciennes
Le problème ne réside pas dans l’entité des Nations Unies elle-même, mais dans la lenteur de sa réponse aux transformations structurelles du monde contemporain. Le monde dans lequel elle a été créée en 1945 n’existe plus : de nouvelles puissances émergent — l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Turquie, l’Indonésie — tandis que le continent africain réclame une représentation équitable au sein du Conseil de sécurité.
Parallèlement, la mondialisation a engendré de nouveaux acteurs qui dépassent les États : géants du numérique, organisations régionales, institutions financières transnationales et ONG qui pèsent parfois autant que les gouvernements. Les menaces actuelles — changement climatique, pandémies, cyberattaques et dérives technologiques — défient les modèles traditionnels de gouvernance internationale et appellent des approches plus audacieuses et innovantes.
L’ONU, conçue à l’origine pour prévenir les guerres entre États, se trouve aujourd’hui confrontée à des conflits hybrides où se croisent politique et économie, sécurité et environnement, numérisation et souveraineté. De là, elle nécessite une pensée nouvelle qui transcende la dualité droit-force, vers une gouvernance humaine capable de protéger à la fois la planète et l’humanité.
Vers le renouveau ou le déclin ?
Face à cette obsolescence, l’organisation tente depuis des années de se réformer. Les initiatives et propositions se multiplient : élargissement du Conseil de sécurité, limitation de l’usage du droit de veto, modernisation de la structure administrative et renforcement des partenariats avec les organisations régionales. Le Secrétaire général António Guterres a appelé à construire une « ONU 2.0 » — plus inclusive et flexible, capable de suivre les transformations techniques et sociales qui secouent le monde.
Mais ces appels se heurtent à un mur d’intérêts : comment réformer un système dont bénéficient ceux qui détiennent le pouvoir de le changer ? La vérité est que la réforme de l’ONU n’est pas seulement une question procédurale, mais une question de volonté politique et de redéfinition même de l’idée de multilatéralisme. Le monde ne sera pas réorganisé autour d’un centre unique, mais remodelé autour de réseaux et d’alliances flexibles. L’ONU devra s’adapter à ce monde en réseau, non pas comme une autorité supérieure, mais comme un médiateur entre les nouveaux pôles de la décision mondiale.
Le dernier symbole d’une universalité fragile
À quatre-vingts ans, l’ONU paraît vieillissante mais plus nécessaire que jamais. Elle représente le dernier exemple de l’idée d’universalité, à une époque déchirée par les communautarismes et les nouvelles guerres froides. Certes, son autorité s’est érodée, mais son absence serait catastrophique. Elle demeure la seule scène où les puissants sont contraints — ne serait-ce que symboliquement — de justifier leurs actes devant la « communauté internationale ».
L’organisation incarne donc un paradoxe profond : elle exprime un monde qui n’existe plus, mais elle porte en elle la seule idée capable de l’unir.
Un questionnement collectif
Le 24 octobre 2025, lorsque le monde célèbre l’anniversaire de la Charte, cette commémoration ne doit pas se transformer en rituel protocolaire, mais en moment de questionnement collectif : voulons-nous encore un ordre international fondé sur le droit ? Et pouvons-nous redonner à la Charte son esprit et son sens, avant qu’elle ne devienne un souvenir sans vie ?
Car si l’ONU s’effondrait, il faudrait immédiatement la réinventer. Non pour répéter les utopies de 1945, mais pour affirmer que la paix, la justice et la solidarité ne sont pas un héritage du passé, mais l’horizon fragile d’une humanité qui tente encore de se gouverner avec une raison et une âme communes.
*Avocat au barreau de Tunis