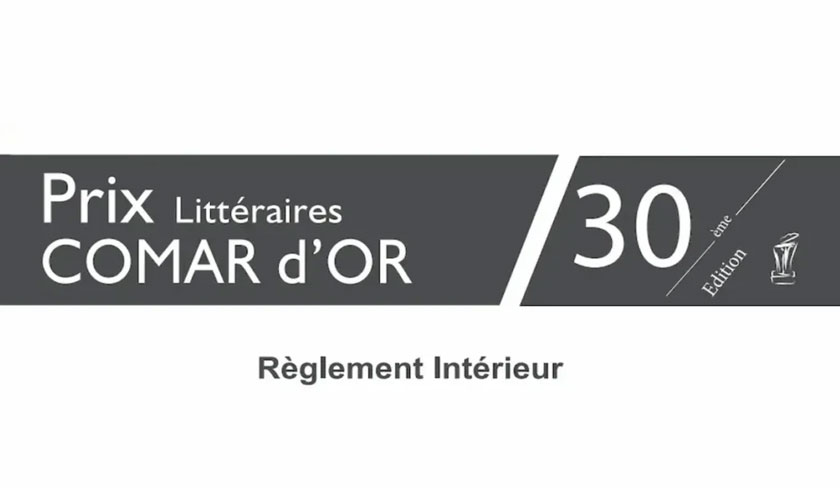Le président Kaïs Saïed n’est pas le premier à avoir invoqué un vers d’un poème du poète Jarir dans son discours politique ; le cheikh Rached Ghannouchi l’avait précédé dans différents contextes politiques.
Cependant, cette convergence spontanée dans la référence ne peut être lue comme une simple répétition rhétorique, mais comme un indice d’une structure symbolique partagée dans l’imaginaire politique tunisien, qui tire sa légitimité davantage du passé que du présent ou de l’avenir.
Cet usage, bien qu’il semble à première vue exploiter la mémoire culturelle commune, révèle en profondeur une crise dans la représentation symbolique et politique. Il reflète l’incapacité de l’acteur politique à générer un vocabulaire sémantique nouveau pour la légitimité, le poussant à recourir à des symboles appartenant à un univers culturel pré-moderne, où le conflit se gère par le biais de l’éloge et de la satire, et non par la preuve et la raison.
Recourir à la culture de l’époque omeyyade dans l’espace de la communication politique contemporaine ne peut être considéré comme une simple variation rhétorique innocente ; c’est un indicateur du désordre dans la relation au temps : tandis que le discours politique cherche à se moderniser dans la forme et le fond, il reste prisonnier de récits hérités qui reproduisent les émotions tribales instinctives et un lexique de domination, d’antagonisme et de vengeance, au détriment de l’enjeu rationnel et discursif du discours politique moderne.
Un langage politique prisonnier du passé
Dans cette perspective, la citation du patrimoine ancien devient le signe d’une double rupture :
une rupture avec le présent dominé par les symboles de la communication numérique et l’interactivité instantanée, et une rupture avec une génération pour laquelle le poème classique en vers n’est plus partie de son système symbolique ou de son horizon d’expression. Pour cette génération, invoquer Jarir ou Al-Farazdaq relève d’une nostalgie stérile ou d’une tentative d’imiter une autorité linguistique désynchronisée, perdant sa pertinence à l’ère de la numérisation et de l’interaction en réseau.
L’usage du passé comme langage de légitimation politique révèle la domination d’une culture de la mémoire évanescente au détriment d’une culture de projet ; au lieu que le discours politique soit un outil de construction de sens, il se transforme en tentative de reproduction de la mémoire comme substitut à la vision. Et en l’absence d’un projet répondant aux questions du réel, le politique ne dispose que d’une rhétorique satirique dépassée, incapable de résister à la logique de la communication nouvelle fondée sur la transparence, l’instantanéité et l’intelligence artificielle interactive.
Du recours au patrimoine à la gouvernance discursive
À la lumière de ce qui précède, cette inclination à convoquer des symboles poétiques anciens peut être lue comme un dysfonctionnement de la gouvernance discursive dans l’espace politique. La gouvernance discursive, en tant qu’organisation symbolique de la relation entre discours, pouvoir et public, exige que l’acteur politique soit capable de produire un discours adapté aux transformations des médias et aux nouvelles modalités de réception. Or, le recours répété au patrimoine poétique ancien révèle une incapacité à gérer le capital symbolique du discours politique et une rupture entre le locuteur et son environnement communicationnel.
Au lieu que la gouvernance discursive s’exerce comme un art de la gestion de la langue permettant de construire la confiance et la circulation rationnelle dans l’espace public, elle se transforme dans ce contexte en mécanisme rétrograde, renvoyant la politique à l’époque de l’éloquence individuelle et de l’émotion rhétorique. Ainsi, l’action communicative basée sur l’argumentation, la participation et la transparence disparaît, remplacée par un discours vertical produisant l’obéissance plutôt que le dialogue, le symbole plutôt que le sens.