Trente ans de prison et 4,8 millions de dinars d’amende, assortis de la confiscation de ses biens : la condamnation de Taïeb Rached, ancien premier président de la Cour de cassation, scelle la chute d’un juge qui avait érigé un système de corruption au sommet de la justice. À ses côtés, des hommes d’affaires et des magistrats condamnés pour blanchiment, corruption et falsification. Mais derrière ce verdict exemplaire se cache une autre histoire : celle d’un pouvoir exécutif qui, de Youssef Chahed à Kaïs Saïed, a su tour à tour fabriquer, puis exploiter, la corruption d’un homme pour servir ses propres desseins.
Taïeb Rached n’était pas un magistrat ordinaire. Ancien premier président de la Cour de cassation, il incarnait l’autorité suprême du pouvoir judiciaire tunisien. En 2020, son nom éclate au grand jour dans une querelle de palais avec le juge Béchir Akremi, alors procureur de la République. Les deux hommes, jadis piliers de la magistrature, s’accusent mutuellement de corruption et de manquements graves.
Mais c’est Rached lui-même qui précipitera sa chute. En novembre 2020, lors d’une apparition télévisée sur la chaine Attessia qui cherchait à le blanchir, il admet, sans précaution, acheter et vendre des biens immobiliers en parallèle de ses fonctions. Une déclaration maladroite, mais suffisante pour provoquer le scandale et la levée de son immunité par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le 16 décembre 2020, Rached est suspendu de ses fonctions. À partir de là, les affaires s’enchaînent : corruption, blanchiment d’argent, concussion, falsification, et même une accusation de viol – classée sans suite en 2023 après des tests ADN. Les soupçons deviennent certitudes, les procédures s’accumulent, et la figure du juge au-dessus de tout soupçon s’effondre lentement.
Premières condamnations : la fin d’un mythe judiciaire
En décembre 2023, le tribunal de Grombalia condamne Rached à deux ans et trois mois de prison pour escroquerie dans une affaire immobilière. Une femme l’accusait d’avoir tenté de s’approprier sa maison après l’avoir louée.
Quelques mois plus tôt, en juillet, il avait été blanchi dans une affaire de viol qui avait nourri la rumeur pendant des mois. Ces épisodes, bien que mineurs à côté de ce qui allait suivre, marquent le début d’un basculement : le juge suprême devient un justiciable ordinaire.
L’affaire centrale : un réseau de corruption au cœur de la Cour de cassation
Le dossier qui a abouti au verdict du 28 octobre 2025 est celui qui pulvérise définitivement l’image de Taïeb Rached comme “premier magistrat du pays” pour en faire le pivot d’un système de corruption organisé entre magistrats et hommes d’affaires.
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines particulièrement lourdes contre l’ensemble du réseau.
- Taïeb Rached, ancien premier président de la Cour de cassation : 30 ans de prison, une amende d’environ 4,8 millions de dinars équivalant à son patrimoine et ses biens immobiliers confisqués.
Autrement dit, la condamnation financière n’est pas symbolique : elle s’accompagne d’une confiscation directe de tout son patrimoine amassé durant sa vie.
- Fethi Jenayeh, homme d’affaires, poursuivi et jugé par contumace car en fuite : 30 ans de prison, une amende d’environ 66,2 millions de dinars, équivalant à ses comptes gelés et ses biens immobiliers.
Le tribunal précise que les montants visent à absorber les avantages financiers tirés de ses activités illégales (contrebande, fausses déclarations douanières, blanchiment d’argent).
- Néjib Ben Ismaïl, homme d’affaires, 27 ans de prison et une amende d’environ 14,8 millions de dinars.
Il est présenté par l’accusation comme l’un des principaux bénéficiaires des interventions de Taïeb Rached et comme l’une des sources de financement des pots-de-vin. Il est notamment accusé d’avoir versé environ six millions de dinars à Taïeb Rached en échange de décisions favorables le libérant et neutralisant les poursuites dont il faisait l’objet.
- Abderrazek Bahouri, magistrat radié : vingt ans de prison.
- Marouane Tlili, magistrat radié : vingt ans de prison.
Ils avaient été nommés par Taïeb Rached, d’abord comme juges d’instruction puis comme membres des chambres de cassation spéciales, pour signer les décisions litigieuses. Les deux sont poursuivis pour faux et usage de faux dans des documents judiciaires, corruption et participation à un mécanisme de blanchiment.
- Adel Jenayeh : deux ans de prison et une amende d’environ 177.000 dinars.
Son nom apparaît dans les dossiers douaniers et de blanchiment d’argent liés à son frère.
- Kamel Taboubi, agent immobilier : quatorze ans de prison et une amende d’environ 2,3 millions de dinars.
Il est décrit comme l’un des facilitateurs du passage de fonds et de biens immobiliers, utiles à blanchir l’argent et à couvrir les avantages indus.
- Ouardi Nouisri, jugé par contumace car en fuite : six ans de prison et une amende de 89.000 dinars.
En plus des peines pénales individuelles, la cour a accepté la constitution de l’État tunisien comme partie civile. Elle a condamné Taïeb Rached, Abderrazek Bahouri, Marouane Tlili et Fethi Jenayah à verser en solidarité 935.000 dinars à l’État tunisien, au titre des dommages causés à l’intérêt public.
Une véritable bande organisée
Les chefs d’accusation retenus contre ce groupe sont constitution d’un réseau structuré en vue de blanchir de l’argent, corruption active et passive, faux et usage de faux dans des documents officiels, abus d’influence et exploitation des facilités liées à la fonction et manipulation des procédures judiciaires au sommet de l’appareil judiciaire.
Le tribunal décrit un système où le sommet de la magistrature intervenait directement pour neutraliser ou effacer des poursuites contre des hommes d’affaires poursuivis pour contrebande, fraude douanière, fausses déclarations de valeur, évasion fiscale et blanchiment d’argent. Les pertes pour l’État tunisien sont évaluées par l’accusation à environ six millions de dinars.
Ce noyau dur – Taïeb Rached, des juges qu’il a personnellement nommés, et des acteurs économiques poursuivis pour fraude douanière et blanchiment – est présenté comme une structure cohérente, pas comme une simple somme de dossiers isolés. C’est précisément ce caractère “organisé”, et la capacité de Rached à mettre la Cour de cassation elle-même au service de ce mécanisme, qui justifie le niveau exceptionnel des peines prononcées.
Les origines du scandale : la manipulation des “décisions sans renvoi”
Tout part d’une série de décisions de cassation “sans renvoi” rendues entre 2018 et 2019.
Ces jugements permettaient d’annuler des condamnations sans les renvoyer devant d’autres juridictions, effaçant purement et simplement les poursuites.
Rached, alors procureur général près la Cour d’appel, puis président de la Cour de cassation, aurait créé deux chambres spéciales, numérotées 35 et 36, pour traiter ces affaires sensibles.
Ces chambres “d’été” auraient servi à blanchir la situation judiciaire de plusieurs hommes d’affaires poursuivis pour évasion fiscale, contrebande et blanchiment d’argent.
L’enquête révèle que ces deux chambres ont statué sur huit dossiers majeurs de corruption financière. Parmi les bénéficiaires : Néjib Ben Ismaïl et Fethi Jenayeh, qui ont vu leurs poursuites effacées par des décisions de cassation rendues “sans renvoi”.
Un système organisé : pots-de-vin, manipulations et faux juges
Selon les éléments du dossier, rapportés par des médias réputés proches du parquet, Taïeb Rached aurait touché six millions de dinars de la part de Néjib Ben Ismaïl pour influencer le verdict d’une affaire financière le visant.
Cette somme, versée en plusieurs tranches, aurait transité par des sociétés-écrans et des intermédiaires immobiliers.
Les rapports de la Direction de l’Inspection générale du ministère de la Justice détaillent aussi comment Taïeb Rached a contourné les règles procédurales.
En août 2018, il charge une chambre d’accusation non compétente d’examiner la demande de libération de Néjib Ben Ismaïl, entraînant sa remise en liberté automatique pour dépassement de la durée légale de détention.
Il fait ensuite désigner un avocat non mandaté pour déposer un recours hors délai, accepté malgré tout grâce à son influence.
En 2019, il impose la création de chambres d’été, placées sous l’autorité de juges qu’il choisit lui-même, dont l’un souffrait d’un handicap mental de 67 %, incapable de comprendre les dossiers. Ce magistrat a reconnu n’avoir jamais pris connaissance des affaires qu’il tranchait.
Ces manipulations ont eu un effet concret : annulation des poursuites contre plusieurs hommes d’affaires, pertes estimées à six millions de dinars pour l’État, et effacement de dossiers de fraude douanière, fiscale et bancaire.
Une machine judiciaire dévoyée
Les témoignages recueillis par l’Inspection du ministère de la Justice révèlent l’existence d’un “circuit parallèle” au sein de la Cour de cassation.
Taïeb Rached y aurait choisi lui-même les dossiers, sélectionné les juges et imposé les verdicts, créant une chaîne d’influence où tout s’achetait : liberté, effacement, décision favorable.
Un vice-président de la Cour de cassation de l’époque a déclaré que Taïeb Rached “avait préparé une liste spéciale des affaires jugées sensibles, notamment celles émanant du Pôle financier et du Pôle antiterroriste”.
Le dossier évoque aussi des décisions suspectes en faveur d’hommes d’affaires poursuivis dans des affaires douanières et de contrebande, notamment Adel Jenayeh et Youssef Mimouni, dans ce qu’on a appelé l’affaire “BH Bank”.
Le procès et le verdict : un symbole d’autorité retrouvée
Après plusieurs reports et des années d’enquête, la chambre criminelle spécialisée a rendu son verdict le 28 octobre 2025, à l’issue d’un procès marathon.
La condamnation de Rached, de ses complices magistrats et des deux hommes d’affaires marque la première fois dans l’histoire judiciaire tunisienne qu’un ancien premier président de la Cour de cassation est jugé et condamné pour corruption et blanchiment d’argent.
Le jugement, qui s’accompagne d’amendes cumulées dépassant 90 millions de dinars, est présenté par le parquet comme un “signal fort de la lutte contre la corruption”.
Mais dans les milieux judiciaires, certains y voient aussi une affaire instrumentalisée pour restaurer l’image d’une justice malmenée par des années de crise de confiance.
Une nomination politique dès l’origine
L’histoire ne commence cependant pas avec la chute de Taïeb Rached, mais avec son ascension. En 2018, alors que Youssef Chahed était chef du gouvernement, le poste de premier président de la Cour de cassation faisait l’objet de tractations entre la Kasbah et plusieurs magistrats pressentis.
Selon le témoignage du journaliste Mohamed Yousfi, un conseiller influent de Youssef Chahed, le juge Belhassen Ben Amor, aurait contacté trois candidats potentiels pour évaluer leur “disponibilité politique”. Lors d’un échange avec un magistrat réputé intègre et hautement qualifié, Ben Amor lui aurait posé cette question : « Qu’allez-vous nous offrir si vous obtenez ce poste ? » Le juge aurait simplement répondu : « La justice et le droit. »
La conversation s’est arrêtée là, et le dossier du candidat a disparu des circuits de promotion. À sa place, c’est Taïeb Rached qui a été nommé, jugé plus “gérable” par le pouvoir exécutif. Ce choix ne doit rien au hasard : il répondait à une logique politique visant à placer à la tête du corps judiciaire un homme malléable, capable de garantir au pouvoir une loyauté implicite plutôt qu’une indépendance réelle.
Une récupération politique sous Kaïs Saïed
Le changement de régime n’a pas assaini le rapport entre le pouvoir exécutif et la justice. Sous Kaïs Saïed, les manipulations ont simplement changé de forme.
En juin 2022, le président a radié 57 magistrats, présentés comme corrompus ou partisans, et Taïeb Rached figurait en tête de cette liste.
Hier, à l’annonce de sa condamnation à trente ans de prison, les partisans du régime ont exulté, estimant que ce verdict confirmait la justesse de la purge décidée par le chef de l’État.
Mais la réalité est tout autre. La majorité des magistrats radiés étaient intègres. Leur seul tort : avoir refusé d’obéir à un pouvoir qui exigeait d’eux une soumission politique. 47 parmi eux ont d’ailleurs obtenu gain de cause devant le tribunal administratif, qui a ordonné leur réintégration. Pourtant, le ministère de la Justice refuse toujours d’exécuter ces jugements.
En amalgamant Taïeb Rached, véritable symbole de corruption, et les magistrats injustement radiés, le régime a volontairement brouillé les repères. Cette confusion, exploitée à des fins de propagande, salit l’ensemble du corps judiciaire et renforce la méfiance du public envers la magistrature tunisienne.
La condamnation de Taïeb Rached, censée tourner la page d’un système dévoyé, risque paradoxalement de prolonger la crise de confiance dans la justice tunisienne — une institution désormais sommée de prouver qu’elle peut, un jour, se libérer de la tutelle du pouvoir.
Maya Bouallégui



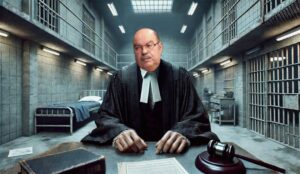





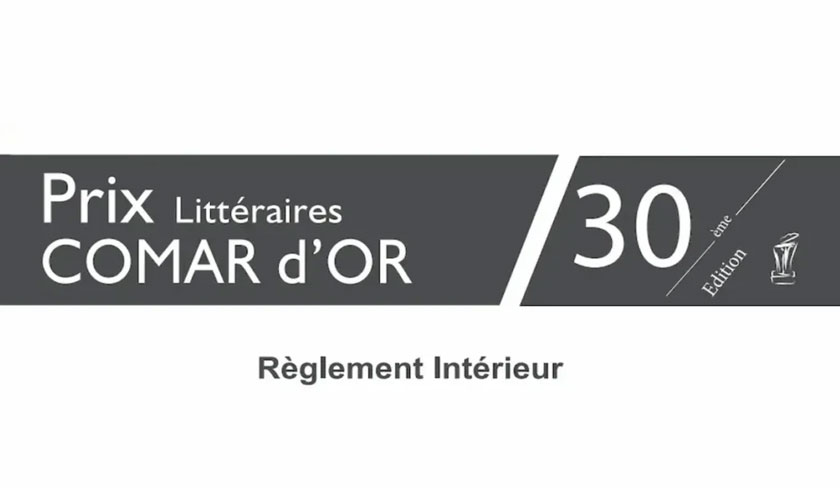


2 commentaires
ZARZOUMIA
POUR DIRE ,qu’un escroc , bandit , voleur , menteur et trafiquant ÉTAIT À LA TÊTE DE LA COUR DE CASSATION !! et ne doit pas etre le seul dans l’administration tunisienne , IL Y A ENCORE DU BOULOT .
zaghouan2040
Le réseau mafieux décrit ne constitue pas une surprise; pareilles organisations criminelles infiltrent, structurent meme, l’ensemble de l’administration tunisienne
Je note avec tristesse mais aussi compréhension que BN n’a pas cité certains fonctionnaires qui continuent d’ailleurs d’exercer leur « responsabilité régaliennes » ; c’est à dire de continuer a exercer leurs méfaits
Le réseau Rached est tout sauf une exception ! Il existe toujours des réseaux beaucoup plus dangereux et impliquant des centaines d’individus sans que l’Etat n’ai pour l’instant agit
Impossible que le pouvoir ne soit pas au courant de ces réseaux criminels
Des questions angoissantes et lancinantes ne peuvent qu’être posées