La Tunisie s’apprête à renouer avec les marchés financiers internationaux pour lever 400 millions d’euros, une première émission obligataire depuis 2019. Officiellement, il s’agit d’un signe de confiance retrouvée. En réalité, l’État s’endette à marche forcée pour financer ses dépenses courantes, au prix de taux exorbitants et d’une perte croissante de cohérence économique et politique.
La ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, a annoncé, le 30 octobre 2025, la préparation d’un emprunt obligataire international d’environ 400 millions d’euros. Ce retour est présenté comme une étape prudente et mesurée, symbole d’une stratégie de financement « diversifiée et souveraine ».
Mais derrière cette communication policée, le constat est clair : la Tunisie revient sur les marchés parce qu’elle n’a plus le choix. L’État a besoin d’argent pour boucler un budget sous tension et rembourser une dette devenue asphyxiante. En 2026, une part considérable des ressources publiques sera encore absorbée par le service de la dette intérieure et extérieure.
La ministre a assuré que la Tunisie « emprunterait à ses conditions ». Une formule trompeuse, presque surréaliste, dans un monde financier où ce sont toujours les prêteurs qui fixent les règles. Aucun pays, encore moins un État noté B- et privé de l’appui du FMI, ne peut imposer ses conditions à des investisseurs qui exigent des rendements élevés pour compenser le risque.
Par ailleurs, la Tunisie n’a pas totalement disparu du radar financier international depuis 2019. Le pays a contracté plusieurs prêts extérieurs, notamment auprès d’Afreximbank : 700 millions de dollars en 2022, puis 500 millions fin 2024. Ce dernier crédit a été adopté par le Parlement dans la précipitation, sans que les députés aient eu accès aux détails de l’accord. Le gouvernement présente donc la nouvelle émission comme un « retour », mais la réalité est plus nuancée : il s’agit surtout d’une nouvelle étape dans une fuite en avant financière.
Officiellement, le gouvernement affirme vouloir préserver sa « souveraineté budgétaire ». Dans les faits, la Tunisie n’a jamais été aussi dépendante de ses créanciers.
L’illusion d’une souveraineté financière
Cette stratégie s’inscrit à rebours du discours présidentiel. Depuis 2021, Kaïs Saïed martèle son refus de recourir aux institutions financières internationales, répétant que « nous devons compter sur nous-mêmes ». Ce leitmotiv souverainiste est devenu l’un des piliers de sa rhétorique politique. Mais sur le terrain économique, la réalité est bien différente : le pays s’endette davantage, souvent dans les pires conditions, et sans perspective de réforme structurelle.
La note souveraine de la Tunisie a été dégradée à plusieurs reprises depuis le 25 juillet 2021, date du coup de force présidentiel. Seule Fitch Ratings a relevé légèrement la note, de CCC+ à B- il y a quelques semaines, estimant que les équilibres budgétaires s’étaient temporairement stabilisés. Cette révision demeure modeste et isolée. Moody’s et Standard & Poor’s, pour leur part, n’ont procédé à aucune amélioration et maintiennent la Tunisie dans la catégorie spéculative, avec des perspectives incertaines.
Surtout, les grandes institutions internationales ne partagent pas l’optimisme affiché par le gouvernement. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont, au contraire, révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Tunisie en 2025, soulignant l’absence de réformes, la fragilité du secteur bancaire et la dépendance accrue aux financements de court terme. Les indicateurs sociaux se dégradent, le chômage des jeunes reste élevé et l’inflation continue d’éroder le pouvoir d’achat.
Refuser le FMI ne signifie donc pas retrouver la souveraineté, mais s’en priver. En s’isolant volontairement, la Tunisie ferme la porte aux financements concessionnels, aux taux d’intérêt réduits et aux garanties multilatérales qui rassurent les marchés. L’accord avec le FMI ne serait pas une perte d’indépendance, mais un sceau de crédibilité financière. À l’inverse, l’entêtement actuel alimente la méfiance des investisseurs et renchérit le coût de chaque dinar emprunté.
Le paradoxe est total : au nom d’une indépendance proclamée, l’État s’enfonce dans une dépendance financière encore plus sévère, sans réforme ni stratégie à long terme.
Des emprunts sans trace, au prix le plus élevé de l’Histoire
Ce refus d’intégrer le cadre multilatéral ne s’est pas accompagné d’une plus grande transparence nationale. Bien au contraire, l’endettement s’est déplacé à l’intérieur du pays, à l’abri des regards, sous la forme de prêts directs contractés auprès de la Banque centrale.
L’économiste Ridha Chkoundali a tiré la sonnette d’alarme : l’État tunisien a contracté deux emprunts directs auprès de la BCT — sept milliards de dinars en 2024 et autant en 2025 — sans la moindre visibilité sur leur destination. « Nous ne savons rien de ces fonds, ni où ils ont été dépensés », déplore-t-il.
Or, les règles économiques élémentaires imposent que ce type de financement soit réservé aux projets productifs, créateurs de valeur. Utilisés pour combler le déficit courant, ces fonds deviennent dangereux pour la stabilité monétaire et nourrissent une illusion budgétaire.
Autrement dit, la Tunisie s’endette pour vivre, non pour investir. L’État finance ses salaires, ses subventions et ses charges administratives par l’emprunt, c’est-à-dire en hypothéquant son avenir. Ce n’est plus une politique économique, mais une survie comptable.
Pour Walid Bel Hadj Amor, économiste et ancien membre de l’Institut arabe des chefs d’entreprise, la sortie sur le marché international sera tout sauf anodine. Le pays ne fixe pas ses conditions : ce sont les investisseurs qui imposent les leurs.
Avec une note B-, la Tunisie se retrouve dans la catégorie des émetteurs à haut risque. Peu d’institutions acceptent de prêter à un État si mal noté, et celles qui le font exigent une prime élevée. Selon M. Bel Hadj Amor, une émission à 400 millions d’euros, sans garantie, pourrait se solder par un taux d’intérêt entre 9 % et 12 %, soit le coût le plus élevé jamais supporté par la Tunisie.
Le paradoxe est flagrant : un accord avec le FMI aurait permis d’abaisser ces taux, mais le refus politique de Carthage enferme le pays dans une spirale où la défiance se paie comptant.
Une dette qui hypothèque l’avenir
Au-delà des chiffres et des notations, une vérité s’impose : la Tunisie s’endette sans construire. Les nouveaux crédits ne financent ni infrastructures, ni réformes structurelles, ni création de valeur durable. Ils alimentent des dépenses courantes d’un État hypertrophié, miné par le court-termisme.
Un emprunt n’est pas une faute en soi lorsqu’il sert à bâtir — routes, école publique, productivité, innovation. Ce qu’il faut redouter, c’est l’endettement improductif : celui qui couvre les déficits d’une administration obèse et reporte indéfiniment les réformes.
Ce sont, très concrètement, nos enfants qui paieront demain les crédits contractés aujourd’hui pour régler des salaires et des dépenses farfelues et inutiles — sociétés communautaires, recrutements dans une administration déjà en sureffectif — au lieu de financer des actifs productifs. Cette logique étouffe l’investissement privé, verrouille la croissance potentielle et transforme la dette en injustice intergénérationnelle.
La Tunisie s’endette pour tenir, non pour croître. Tant que cette mécanique perdurera, le pays avancera dans le brouillard, porté par l’illusion d’une souveraineté déjà perdue.
La pire dépendance n’est pas celle qu’on avoue au FMI, mais celle qu’on impose à ses enfants.
Maya Bouallégui








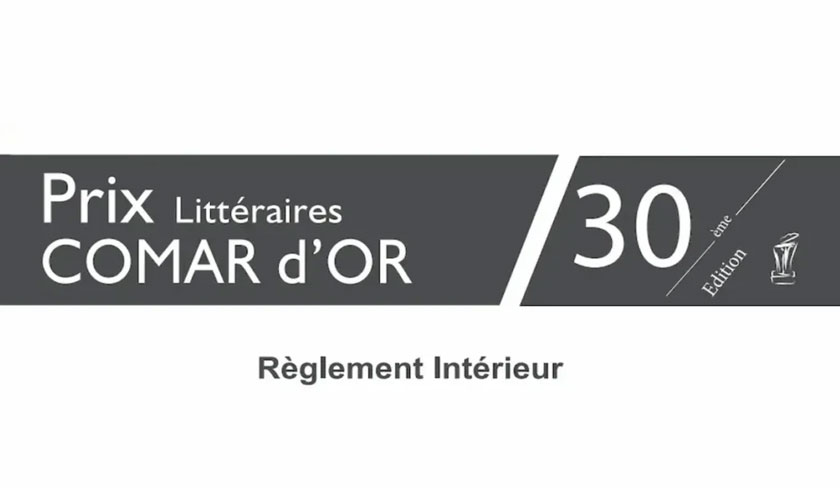



9 commentaires
Citoyen_H
L’ÉTAT, DEPUIS L’ARRIVÉE DE
Kaissoune au pouvoir, ne cesse, jour et nuit, de réparer les dégâts considérables, perpétrés par les bédouins de la maudite terka !!!
Par conséquent, soyons humbles et essayons de rester pudiques !!!
abdelmoula.bahri
Certains n’ont du pouvoir que le pouvoir de nuisance !
NUISANCE
Ecrit par A4 – Tunis, le 23 Janvier 2019
Moi je plains tous ces enfants
Je plains ces pauvres marmots
Qui sautillent insouciants
Les pieds nus dans les flaques d’eau
Je plains ces petits gamins
Qui rigolent tous en chœur
Qui barbouillent des dessins
Y mettant plein de couleurs
Moi je plains ces petits qui
Par malchance ont des parents
Qui s’inventent des acquis
Archaïques et aberrants
Des parents qui veulent tout
Mais qui n’ont rien dans la tête
Mis à part des désirs fous
Ne laissant que plein de dettes
Je les plains car moi je sais
Que quand finit la récré
Pas de tirelire à casser
Aucun trait n’est à tirer
Moi je sais que c’est à eux
De vider toutes leurs poches
Pour payer les goûts ruineux
De papa, maman et proches
Ils seront bien sûr contraints
De travailler comme des fous
Pour rembourser les emprunts
Des fainéants et des voyous
Ils ne seront qu’obligés
De se griller les méninges
Pour trouver comment payer
Avec cette monnaie de singe
Je suis sûr qu’ils auront honte
De cette lignée de ratés
Qui n’a laissé dans ses comptes
Que des trous à colmater
Je les plains ces pauvres mômes
Qui se font bien arnaquer
Par des ignares, des sous-hommes
Voraces et mal éduqués
Je plains ce maudit pays
Sans ressort et sans déclic
Où chacun nous envahit
Avec ses plans diaboliques
Puis avec délectation
Et en toute insolence
Il met en application
Son pouvoir de nuisance
zaghouan2040
La spirale mortelle des emprunts non productifs opaques et au détriment du soutien aux PMEs est l’illustration parfaite de la mal gouvernance de ce pauvre pays
Nos pseudo responsables ,tout juste bons à détourner l’aide de la Banque Mondiale pour la lutte anti-Covid se foutent éperdument des conséquences de cette politique insensée inconcevable sur les deux prochaines générations et d’ailleurs n’ont aucune strategie d’adaptation technologique économique sociale environnementale au basculement a venir
Mhammed Ben Hassine
B.N
Peut on espérer un article expliquant d’une manière simple les différents regimes d’impositions des différents agents économiques salariés et non salariés
Merci
Mhammed Ben Hassine
emprunterait à ses conditions…hehe..
Les faibles ne s’endettent jamais à leurs conditions c’est contre nature et du non sens
Monir Bpukhris
Je soutiens notre président Mr Kaïs Saïed.
vous êtes les ennemis de la Tunisie arrêtez votre propagande vous servez les intérêts des puissances étrangères c’est flagrant ont se laissera pas faire je vous maudit bande de traître business news j’espère que l’état fermera votre site
Mhammed Ben Hassine
[symbole d’une stratégie de financement « diversifiée et souveraine »]
Mon œil…..
S’endetter c’est concasser sa propre souveraineté
Hannibal
Franchement qu’attendez-vous de quelqu’un qui confond millions et milliards ?
L’image générée par IA qui accompagne l’article illustre très bien le danger : l’Etat est sous perfusion et nos enfants subiront la mauvaise gestion de la dette comme un boulet aux pieds.
Si on s’endette pour payer les salaires de fonctionnaires en surnombre et non pas pour booster l’économie et assurer un avenir serein, c’est un krach qui attend le pays.
HatemC
L’État en faillite morale et financière
Le dernier emprunt international de 400 millions d’euros n’est pas un signe de confiance, mais un aveu d’échec. La Tunisie ne s’endette plus pour investir, mais pour survivre. Derrière le langage technocratique de la ministre des Finances, c’est un pays en cessation de projet, dirigé par un président qui confond pouvoir et mission.
Kaïs Saïed s’accroche à la présidence comme à un totem, incapable de concevoir que gouverner, c’est anticiper, réformer, bâtir. Autour de lui, des ministres sans vision répètent une rhétorique de “souveraineté” vide de contenu. Pendant qu’ils invoquent l’indépendance budgétaire, ils contractent des prêts aux taux les plus élevés de l’histoire du pays, sans contrôle, sans transparence, sans impact économique durable.
Le gouvernement prétend “emprunter à ses conditions”. Mais c’est le contraire : les marchés imposent leurs taux, les créanciers dictent leurs clauses, et la Tunisie paie cash l’isolement diplomatique provoqué par le refus du dialogue avec le FMI et les partenaires internationaux. En croyant protéger la souveraineté nationale, le régime a précipité la dépendance la plus humiliante : celle du court terme, du crédit à tout prix, de la survie comptable.
Un président qui trahit sa mission trahit son peuple.
L’État, vidé de sens, ne tient plus que par la peur et la dette.
Le moment est venu de dire stop : le pays doit siffler la fin de la partie avant que la faillite ne devienne irréversible…. et demander à ce type de quitter la présidence et laisser des compétents à diriger ce pays moribond ….
Kaïs Saïed n’a tiré aucune leçon de l’ancien régime, il en reproduit les erreurs, la centralisation du pouvoir, le mépris du dialogue et l’illusion de la toute-puissance de l’État.
Kaïs Saïed, enfermé dans sa certitude et son isolement, répète les erreurs des régimes qu’il prétendait corriger.
Comme tous les dirigeants qui confondent autorité et vérité, il finira par être rattrapé par la même loi historique : aucun pouvoir fondé sur la peur et le déni ne dure.
L’histoire de la région est claire — ceux qui refusent d’écouter finissent toujours par être balayés.
La Tunisie, elle, survivra. Mais sans lui …. et partagera les pages sombres de l’Histoire de ce pays ….HC