Par Amin Ben Khaled, Avocat au barreau de Tunis
Face aux guerres, au populisme, à la justice instrumentalisée, aux crises climatiques et à l’intelligence artificielle, le philosophe athénien nous rappellerait que l’examen critique reste notre plus précieux rempart contre la déraison collective.
Il y a vingt-cinq siècles, sur l’agora d’Athènes, un homme questionnait inlassablement ses concitoyens. Socrate ne prétendait rien savoir, mais son ignorance assumée révélait l’illusion de savoir d’autrui. Aujourd’hui, dans un monde saturé d’informations et de certitudes péremptoires, que dirait ce sage ironique face à nos crises multiples ? Sa méthode maïeutique, cet art d’accoucher les esprits de leurs propres vérités, conserve une pertinence troublante à l’heure où les sophismes prospèrent sur les réseaux sociaux et où les démagogues prospèrent dans l’agitation des peurs collectives.
La guerre ou l’échec du dialogue
« Nul n’est méchant volontairement », affirmait Socrate, convaincu que l’injustice procède de l’ignorance. Face aux conflits qui ensanglantent l’Ukraine, le Proche-Orient et tant d’autres régions, le philosophe aurait sans doute interrogé cette faillite du logos, cette incapacité à faire prévaloir la raison sur la violence. Non par naïveté pacifiste, lui qui combattit vaillamment lors de la guerre du Péloponnèse, mais parce qu’il voyait dans le dialogue la seule voie vers une paix véritable.
Socrate aurait probablement dénoncé la rhétorique belliciste qui transforme l’adversaire en ennemi absolu, déshumanisé, placé hors du cercle de l’humanité pensante. Cette désignation de l’autre comme mal incarné, cette diabolisation qui dispense de comprendre, relève précisément de cette paresse intellectuelle qu’il combattait. Car comprendre les motivations de son ennemi, ce n’est pas les justifier, mais se donner les moyens de désamorcer le conflit à sa racine. Le philosophe athénien nous rappellerait que la guerre commence toujours par un renoncement au questionnement.
Dans nos démocraties modernes, où les décisions de guerre se parent du langage technique de la géopolitique et des intérêts stratégiques, Socrate poserait cette question simple et redoutable : « Sais-tu vraiment pourquoi tu envoies tes enfants à la mort ? » Il démasquerait les fausses évidences, les raisonnements circulaires qui justifient la violence par la nécessité de répondre à la violence. Non pour paralyser l’action face à l’agression, mais pour exiger des dirigeants qu’ils sachent véritablement ce qu’ils font, et non qu’ils se contentent de croire le savoir.
Le populisme ou le triomphe des sophistes
Si un phénomène devait susciter la colère froide de Socrate, ce serait bien le populisme contemporain. Car ces démagogues modernes qui flattent les foules en prétendant incarner leur volonté pure, ces tribuns qui substituent l’émotion au raisonnement et la simplification à la complexité, ne sont que les héritiers directs des sophistes que le philosophe athénien combattit toute sa vie.
Les sophistes vendaient l’apparence du savoir, l’art de convaincre sans se soucier de la vérité. Ils promettaient à leurs disciples de triompher dans les débats publics grâce à des techniques rhétoriques efficaces, indépendamment du bien-fondé de leurs arguments. N’est-ce pas exactement ce que font les populistes d’aujourd’hui, qui maîtrisent l’art de la formule qui frappe, de la simplification qui rassure, tout en cultivant un mépris assumé pour l’expertise et l’analyse nuancée ?
Socrate aurait particulièrement ciblé cette prétention à « dire ce que le peuple pense vraiment », cette usurpation de la voix collective par des individus qui instrumentalisent les peurs légitimes pour servir leur ambition personnelle. Le vrai démocrate, à ses yeux, n’est pas celui qui flatte les opinions communes, mais celui qui aide ses concitoyens à les examiner, à en déceler les contradictions, à les affiner par le questionnement. La démocratie authentique exige des citoyens éclairés, non des masses manipulées par des slogans.
Face à ces nouveaux sophistes, Socrate opposerait sa méthode : questionner leurs certitudes, révéler l’inconsistance de leurs promesses, montrer que sous le vernis des belles paroles se cache souvent le vide de la pensée. Il rappellerait que le courage politique véritable consiste à dire des vérités difficiles, non à caresser l’opinion dans le sens du poil.
La justice instrumentalisée ou la trahison de Thémis
Condamné à mort par un tribunal démocratique pour avoir « corrompu la jeunesse », Socrate connaissait intimement la justice instrumentalisée. Son procès fut politique, visant à faire taire une voix dissidente dans une Athènes fragilisée par la défaite militaire et les troubles civils. Que dirait-il aujourd’hui de ces pays où la justice devient l’arme des puissants contre leurs opposants, où l’indépendance judiciaire s’érode sous les pressions politiques ?
Le philosophe athénien distinguait soigneusement les lois de la cité, qu’il respectait même injustes, et la justice véritable, cette harmonie de l’âme qui transcende les codes légaux. Il refusa de s’évader de prison parce qu’il avait choisi de vivre dans la cité athénienne et d’en accepter les lois, même quand elles se retournaient contre lui. Mais ce respect des lois n’impliquait aucune soumission intellectuelle : jusqu’au bout, il affirma son innocence et dénonça l’injustice du verdict.
Cette distinction reste d’une actualité brûlante. Socrate nous inviterait à ne jamais confondre la légalité avec la légitimité, le droit positif avec la justice substantielle. Il questionnerait ces magistrats qui plient sous les pressions politiques, ces procureurs qui adaptent leurs poursuites aux rapports de force, ces dirigeants qui utilisent l’appareil judiciaire pour neutraliser leurs adversaires. « Préfères-tu avoir raison devant les hommes ou devant ta conscience ? » demanderait-il à ces serviteurs infidèles de Thémis.
Dans un monde où les procès retentissants se multiplient, où les affaires judiciaires deviennent des armes de guerre politique, Socrate rappellerait cette vérité essentielle : une société qui instrumentalise sa justice se détruit elle-même, car elle sape le socle de confiance sur lequel repose tout vivre-ensemble.
La crise climatique ou l’hubris contemporaine
Face à la dévastation écologique que nous infligeons à notre planète, Socrate aurait probablement diagnostiqué une forme d’hubris, cette démesure que les Grecs considéraient comme le péché suprême. L’hubris, c’est croire qu’on peut tout se permettre, qu’aucune limite ne s’impose à notre puissance, que la nature est un simple réservoir de ressources à exploiter sans retenue.
Le philosophe athénien, qui vivait simplement et méprisait l’accumulation de biens matériels, aurait interrogé notre modèle de développement : « Sais-tu vraiment ce dont tu as besoin pour être heureux ? » Cette question, apparemment naïve, révèle l’imposture d’une civilisation qui confond croissance économique et épanouissement humain, consommation et satisfaction, avoir et être.
Socrate aurait particulièrement ciblé notre mauvaise foi collective face à l’urgence climatique. Nous savons ce qu’il faut faire, les scientifiques nous l’expliquent depuis des décennies, mais nous ne le faisons pas. Cette dissonance cognitive massive, cette capacité à savoir et à ne pas agir en conséquence, aurait fasciné et indigné le philosophe. Il y aurait vu la preuve que nous ne savons pas vraiment, que notre savoir reste superficiel, qu’il n’a pas pénétré jusqu’à cette profondeur de l’âme d’où jaillissent nos actes.
Car pour Socrate, savoir véritablement, c’est agir conformément à ce savoir. Si nous continuons à détruire les conditions de notre survie collective tout en prétendant comprendre les enjeux, c’est que notre compréhension reste théorique, intellectuelle, non incorporée à notre être. Le philosophe nous inviterait à ce travail d’appropriation profonde de la vérité écologique, seul capable de transformer notre comportement.
L’intelligence artificielle ou le nouveau défi de la connaissance de soi
« Connais-toi toi-même », proclamait l’inscription du temple de Delphes que Socrate fit sienne. Face à l’émergence de l’intelligence artificielle, cette injonction résonne avec une force nouvelle. Car pour la première fois dans l’histoire humaine, nous créons des machines capables de simuler certaines fonctions de notre intelligence. Cette confrontation avec notre propre reflet algorithmique nous force à nous interroger : qu’est-ce qui fait notre humanité ?
Socrate aurait probablement accueilli l’IA non comme une menace, mais comme une opportunité philosophique extraordinaire. Ces machines qui conversent, raisonnent et créent nous obligent à préciser ce qui nous distingue d’elles. Est-ce la conscience ? L’intuition morale ? La capacité à questionner le sens de notre existence ? En nous contraignant à définir ce qui nous est propre, l’IA nous ramène au projet socratique fondamental : mieux nous comprendre nous-mêmes.
Le philosophe athénien aurait toutefois mis en garde contre deux tentations symétriques. D’abord, celle de diviniser ces outils, de leur attribuer une sagesse qu’ils ne possèdent pas. L’IA peut traiter des volumes massifs d’information, mais elle ne pense pas au sens socratique du terme : elle ne questionne pas ses propres fondements, ne doute pas de ses algorithmes, ne cherche pas à accoucher d’une vérité qui la dépasse. Ensuite, celle de nous déresponsabiliser en déléguant nos choix moraux à des machines. Car si l’IA peut nous aider à prendre des décisions, elle ne peut nous dispenser de les assumer.
Socrate nous rappellerait que l’outil le plus sophistiqué ne remplace pas la réflexion critique, que la vitesse de calcul ne supplée pas la profondeur de pensée, et qu’une vie examinée reste la seule digne d’être vécue, qu’elle soit augmentée ou non par l’intelligence artificielle.
L’examen de vie comme résistance
Dans ce monde en crise, saturé de fake news et de certitudes factices, la voix de Socrate résonne comme un appel salvateur. Sa méthode, exigeante et inconfortable, nous enjoint de suspendre nos jugements hâtifs, de questionner nos évidences, de reconnaître les limites de notre savoir. Elle nous rappelle que la sagesse commence par l’humilité intellectuelle et que le dialogue authentique exige de vraiment écouter l’autre, non de simplement attendre son tour pour parler.
« Une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être vécue », affirmait-il devant ses juges. Cette exigence d’auto-examen, cette vigilance critique permanente envers soi-même et le monde, constitue peut-être le plus précieux héritage du philosophe athénien. Face aux guerres, au populisme, aux injustices, au désastre écologique et aux défis technologiques, nous avons plus que jamais besoin de cette attitude socratique : questionner inlassablement, douter des apparences, chercher la cohérence entre nos principes et nos actes.
Socrate ne nous donnerait pas de solutions toutes faites. Il nous poserait des questions. Des questions qui dérangent, qui obligent à penser vraiment, qui révèlent nos contradictions et nos lâchetés. Des questions qui, peut-être, nous permettraient de retrouver le chemin d’une vie véritablement humaine, c’est-à-dire d’une vie qui se soucie du vrai, du juste et du bien, envers et contre tout.







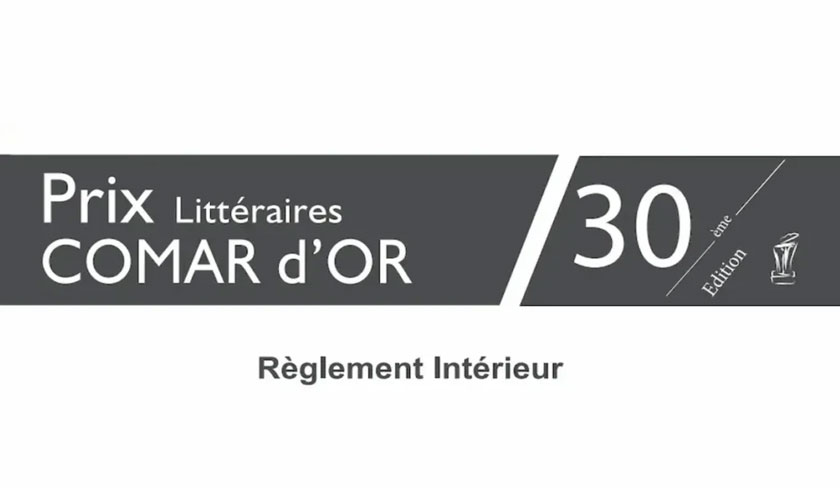



3 commentaires
Gg
En tant que philosophe, Descartes aurait aussi pu dire: je doute, donc je suis.
Les anciens ont historiquement posé le doute comme pilier de la philosophie, rejoignant en cela les scientifiques. Ce n’est pas par hasard si, de tous temps et encore aujourd’hui, les scientifiques ont aussi une approche philosophique de leur discipline.
Le doute est la remise en question incessante des dogmes, des acquis.
Dans l’antiquité on ne parlait pas de sciences et de philosophie, mais de philosophie, dont faisait partie la « philosophie naturelle ».
Un exemple tout simple: pour un observateur attentif sur Terre il est évident que la voûte étoilée tourne autour d’un centre occupé par la Terre.
La remise en cause de cette évidence a consisté à dire que si, à l’inverse, la voute étoilée est fixe et la Terre tourne sur elle-même, nous avons dans les deux hypothèses la même perception des événements.
A partir de là, on discute, on confronte, on argumente, on fait à la gois de la philodophie et de la science.
Juste un mot encore pour dire que la religion, qui interdit le doute et la discution, est par essence l’antinomie de la philosophie!
badie ben ghachem
Pour un avocat cultive je ne peux que réagir par des textes anciens
« Dans cette cité de paysans et de militaires, d’architectes et de soldats, de
juristes et d’artisans, on n’est pas bluffé par les beaux parleurs, mais par les
actions nobles. Voilà pourquoi, à Rome, la philosophie ne se trouve pas
exclusivement dans les mots des philosophes, mais aussi et surtout dans les
belles actions de figures nobles qui incarnent la sagesse de façon pratique dans
leur vie quotidienne. Ces beaux actes, ces beaux gestes servent de modèles.
Rome n’aime les idées que si elles produisent des effets dans le réel ; Athènes
les chérit pour elles-mêmes et pratique l’art pour l’art. Athènes apprécie les
mots, Rome les exemples. »
ou encore « La nourriture spirituelle grec – le dualisme de Pythagore, la
sophistique de Protagoras, l’âme immatérielle de Platon, la métaphysique de la
substance d’Aristote, les hypostases de Plotin, toute cette épicerie idéaliste le
nourrit intellectuellement ; la philosophie universitaire allemande l’a été
également par les mêmes avec ses produits dérivés – le Noumène de Kant,
l’Esprit Absolu de Hegel, l’Essence de Husserl, l’Être de Heidegger, l’En-Soi de
Sartre. Sartre a acclimaté en France cette manie idéaliste qui a produit ses effets jusqu’à ce jour
dans les amphithéâtres de la philosophie officielle – du Collège de France au
Collège international de philosophie, en passant par la Sorbonne ou l’Académie
française, l’École normale supérieure ou le Centre national de la recherche
scientifique. En France, l’existentialisme, le lacanisme, le marxisme, le
structuralisme, la phénoménologie constituent la queue de comète de cet
idéalisme grec. »
Gg
Qu’aurait dit Socrate si, en son temps, l’on avait enseigné aux enfant dès l’âge de trois ans que Zeus est créateur de tout, qu’il faut lui être soumis sans condition ni critique ni le moindre doute, et qu’il faut égorger tous ceux et celles qui ne se soumettent pas, et veulent penser et vivre autrement ?
Le reste n’est que contingence…
(Toute ressemblance avec des personnages ou des événements réels est parfaitement fortuite, bien sûr.)