Par Omar Wesleti
Le matin du 7 novembre 1987, les Tunisiens se sont réveillés sur une voix nouvelle : « Ben Ali président… Bourguiba, c’est fini. »
Ce n’était pas une simple nouvelle. En une seule seconde, le visage du pays a changé. Les foules enthousiastes — habituées à applaudir toute autorité — ont réarrangé leurs slogans et leurs orientations avec une rapidité frappante. En quelques heures, les portraits accrochés aux murs furent remplacés, les mots diffusaient autrement sur les ondes, à l’école et dans les administrations.
Ceux qui brandissaient la photo de Habib Bourguiba en criant « vive la République ! vive Bourguiba, bâtisseur de la Tunisie moderne » reprenaient désormais : « Ben Ali, l’homme de l’étape ; plus d’injustice désormais. »
Ce n’est pas la conscience qui a changé mais l’en-tête ; ce n’est pas la foi dans le système qui s’est effacée, seulement le visage qui l’incarnait.
Les mêmes foules ferventes : elles fabriquent le chef comme on compose une chanson, et la reprennent sans remise en question — prêtes à défendre le régime davantage que la patrie, prêtes à applaudir tout discours porteur de promesses de sécurité et de stabilité. Elles voyaient l’État comme une autorité, non comme un contrat social, et le dirigeant comme un sauveur, non comme un responsable.
Du culte du chef à l’étouffement collectif
Les années ont passé, la poigne sécuritaire s’est resserrée, et le régime a renforcé sa mainmise sur la vie publique. Les slogans ont évolué de « vive la République » à « par l’âme et le sang nous te défendrons, Ben Ali », et le régime est devenu synonyme de l’État lui-même.
Mais le calme apparent dissimulait une suffocation collective, jusqu’à la révolution de 2011 qui a brisé le silence et rouvert la porte à un grand rêve. Les mêmes foules sont descendues dans la rue en scandant un nouveau mot d’ordre : « le peuple veut la chute du régime. » Pour la première fois, le « peuple » semblait devenir le chef. Les vers d’Abou el-Kacem Chebbi résonnaient sur toutes les places : « Si un jour le peuple veut la vie, alors le destin devra s’y plier. »
Pour la première fois, le « peuple » semblait devenir le chef. Les vers d’Abou el-Kacem Chebbi résonnaient sur toutes les places : « Si un jour le peuple veut la vie, alors le destin devra s’y plier.
Le rêve brisé d’une conscience nouvelle
Pourtant, il semble que le destin n’ait pas entièrement répondu. Les visages ont changé, les noms ont changé, mais la manière de penser est restée la même : peur du chaos, nostalgie du chef, quête permanente de « l’homme de la situation ». Les slogans révolutionnaires se sont graduellement transformés en mots d’ordre justifiant le retour du régime, et les mêmes foules qui avaient acclamé la révolution ont commencé à regretter « le temps du régime » au nom de la stabilité et de l’intérêt national.
Changer de dirigeant ne suffit pas
La transformation réelle n’a pas encore eu lieu. Apparemment, nous changeons de dirigeant quand nous nous lassons, mais nous ne changeons pas nous-mêmes, ni ne forgeons une citoyenneté libre. Nous continuons de croire que le salut viendra d’en haut, et non de la société ni de la volonté collective. Ainsi la boucle se referme : de Bourguiba à Ben Ali, de la révolution à ce qui a suivi, chaque fois avec des slogans différents mais un noyau identique : le pouvoir est sacralisé et le peuple se contente d’un rôle secondaire.
Peut-être que si Abou el-Kacem Chebbi revenait aujourd’hui, il reformulerait son vers célèbre ainsi : « si le peuple un jour veut la vie, il doit d’abord vouloir la liberté. »
De novembre 1987 à aujourd’hui, l’expérience s’est répétée sous diverses formes. Nous n’avons pas encore réussi à convertir la « conscience collective » en « conscience citoyenne ». Nous percevons encore l’État comme une autorité qui nous soumet plutôt que comme un contrat qui nous protège, et le dirigeant comme un père qui pardonne ou punit plutôt que comme un fonctionnaire rendu responsable.
Lorsque nous cesserons de confondre le régime avec la patrie, et que nous comprendrons que la liberté est d’abord une responsabilité et non un slogan, alors — peut-être seulement alors — le destin répondra.
Omar Wesleti est membre du conseil de la presse


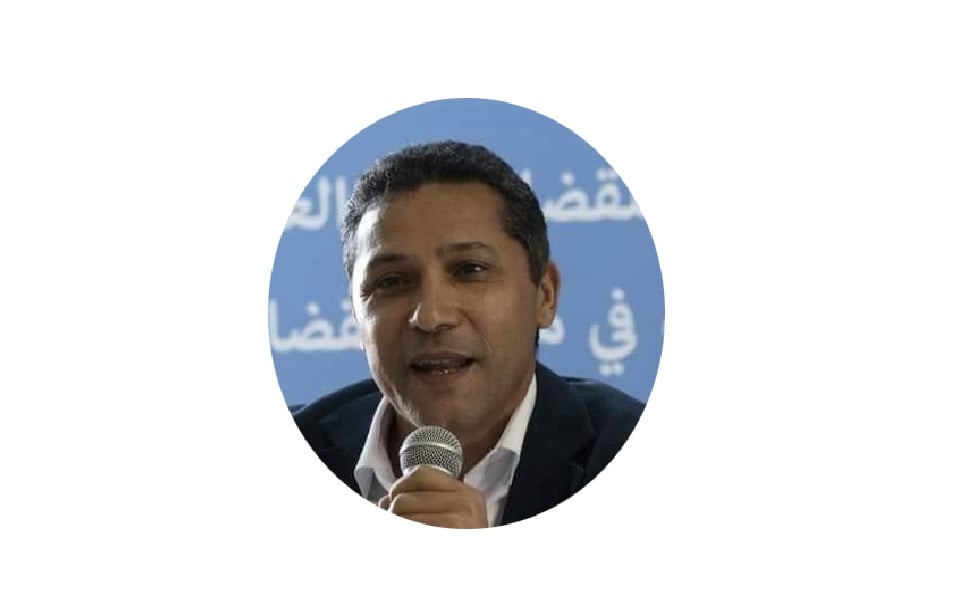








Commentaire
zaghouan2040
La liberté est d’abord une responsabilité et non un slogan
Pas de citoyenneté sans liberté
Nous nous mettons a nous mêmes parce que nous sommes un troupeau d’esclaves
C’est ce que veut ce régime qui n’a pas hésiter à ressusciter la dictature benaliste sans benali
On a remplacé le mot « changement » par « révolution »
Minable et sordide a l’image d’une populace qui n’en finit pas d’être manipulée et constamment humiliée