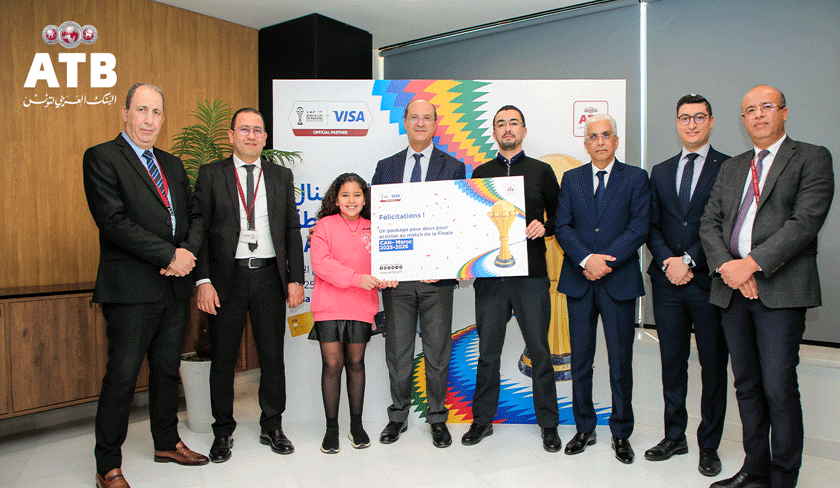Les États-Unis ont confirmé leur décision inédite de boycotter l’Examen périodique universel (EPU) de leurs performances en matière de droits de l’Homme devant l’ONU, prévu vendredi 7 novembre 2025, déclenchant de vives critiques de responsables américains et de défenseurs des droits humains.
La mission américaine à Genève a confirmé cette semaine que les États-Unis laisseraient leur siège vide lors de l’EPU de vendredi après-midi, comme annoncé en août.
Les États-Unis deviennent ainsi l’un des deux seuls pays, avec Israël en 2013, à ne pas se présenter à leur propre examen depuis la mise en place du système d’EPU en 2008 auprès du Conseil des droits de l’Homme.
« C’est profondément décevant », a réagi Uzra Zeya, directrice de Human Rights First, regrettant « un mauvais signal » qui, selon elle, « fragilise un processus qui a contribué aux progrès réalisés en matière de droits humains dans le monde entier, y compris aux États-Unis ».
Mme Zeya doit animer vendredi l’un des nombreux événements organisés à l’ONU à Genève par des militants et élus américains venus exprimer leurs préoccupations concernant la situation des droits humains aux États-Unis, en particulier depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump en janvier.
Cette décision de Washington fait suite au décret du président Donald Trump, en février, ordonnant le retrait de son pays de plusieurs organes de l’ONU, notamment du Conseil des droits de l’Homme (CDH).
Si Donald Trump s’était également retiré du Conseil durant son premier mandat, son administration avait toutefois participé à son examen de 2020.
En août, les États-Unis s’étaient justifiés en affirmant s’opposer « à la politisation des droits humains au sein du système des Nations unies ».
« Le retrait des États-Unis compromet sérieusement l’universalité, non seulement du processus, mais aussi du principe selon lequel le droit international des droits de l’Homme est inaliénable et s’applique à tous de manière égale », a averti devant la presse Phil Lynch, directeur du Service international pour les droits de l’Homme.
« C’est tragique et profondément ironique que nous ayons contribué à l’élaboration des normes américaines et de ce processus dont nous nous retirons aujourd’hui », a également déploré auprès de l’AFP un ancien haut responsable sous couvert d’anonymat.
Signal dangereux
Un autre ancien responsable ayant participé aux précédentes démarches des États-Unis dans le cadre de l’EPU a averti que « cette non-participation a un effet de signal extrêmement dangereux ».
« Nous perdons notre légitimité en matière de leadership sur les droits de l’Homme à l’échelle mondiale… C’est difficile à accepter ».
Cette absence a également provoqué l’indignation de la société civile, qui participe habituellement aux examens en fournissant analyses et recommandations.
Privés de la tribune de l’EPU, de nombreux groupes, universitaires et responsables américains ont fait part de leurs préoccupations en dressant une liste de développements alarmants aux États-Unis.
Ils ont notamment cité la répression de la contestation, la militarisation des contrôles migratoires, le déploiement de la Garde nationale dans les villes américaines, les attaques contre les universités et institutions artistiques, ainsi que les frappes meurtrières contre des bateaux soupçonnés de transporter de la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique.
Nombreux sont ceux qui ont exhorté la communauté internationale à prendre la parole et à soutenir les efforts visant à scruter les actions du gouvernement américain.
« C’est le Conseil des droits de l’Homme, le système des Nations unies et la communauté des nations attachées aux droits humains et à la démocratie qui peuvent faire la lumière sur ces violations », a souligné Chandra Bhatnagar, directrice de la section californienne du Sud de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU).
Robert Saleem Holbrook, directeur du Centre de droit abolitionniste, confirme que « face à l’érosion de nos libertés civiles, ces instances vont revêtir une importance croissante à l’avenir ».
Certains craignent d’ailleurs que l’absence des États-Unis puisse constituer un précédent fâcheux. « Nous espérons que cela ne banalisera pas le retrait du Conseil », a déclaré à l’AFP Sanjay Sethi, codirecteur de l’Artistic Freedom Initiative.
© Agence France-Presse