Par Haytham Jarboui *
Le dernier ouvrage de Hatem M’rad, De la politique. Concept, science et théorie (Nirvana, 2025), représente une somme de réflexions sur la nature, la connaissance et la compréhension de la politique. Il propose une architecture tripartite qui reprend, dans un ordre rigoureusement logique, la distinction entre la politique comme expérience humaine, la science politique comme discipline du savoir, et la théorie politique comme effort de conceptualisation critique. L’auteur, politologue, s’y livre à une entreprise peu courante dans le monde académique tunisien : celle de repenser la politique à partir de ses fondements à la fois philosophiques (concept), épistémologiques (science politique) et normatifs (théorie politique). Comme il l’écrit dans l’introduction, « Cet essai cherche à montrer qu’il est utile d’étudier la politique dans plusieurs de ses dimensions, et à partir d’approches disciplinaires différentes, de n’en négliger aucune, car tant le philosophe que le politiste ou le théoricien du politique peuvent éclairer la compréhension du politique, comprendre certains de ses ressorts et de ses dimensions, décrire et critiquer certaines de ses illusions, apparentes ou dissimulées, négligées par d’autres approches » (p. 17).
L’introduction annonce la couleur. Il s’agit de redonner à la politique son autonomie et sa dignité intellectuelle, après des décennies de malentendus et de déformations, dans un contexte où la confusion entre le politique et le pouvoir, entre la science politique et l’idéologie, entre la théorie et la doctrine, a souvent appauvri la réflexion publique. L’ouvrage de M’rad s’inscrit à contre-courant de cette tendance en réaffirmant la fécondité du questionnement sur la politique en tant qu’expérience humaine de la coexistence, du conflit et de la régulation.
Le concept de politique : entre fondements et dérives
La première partie (p. 21-99), consacrée au concept de politique, explore la genèse de la vie politique depuis la sociabilité (la philia chez les Grecs) jusqu’au réalisme de la lutte pour le pouvoir. La politique y apparaît comme un art de composer avec le pluralisme, un espace d’interaction et de régulation entre les hommes. M’rad y aborde clairement les multiples dérives qui menacent la politique qu’il met sur le compte de « la non-politique », une des innovations du livre (p.77-99) : à savoir la dépolitisation, la sous-politique et l’antipolitique. Ces notions, souvent confondues dans le discours public, sont ici soigneusement distinguées et théorisées. La sous-politique, concept encore peu reconnu, avancé par l’auteur, désigne selon lui une rationalité politique déformée, une régression démocratique issue de la désinstitutionnalisation, voire un « sous-développement de la politique », notamment lorsqu’elle est mal comprise. Ce passage fait d’ailleurs de l’ouvrage un texte particulièrement actuel pour comprendre les failles des transitions démocratiques, et l’incompréhension du politique qu’elle a générée en Tunisie, comme ailleurs. De toutes les manières, dans son esprit, le non politique n’élimine pas le politique (chose impossible), mais déforme son esprit ou le sort de son contexte réel et authentique.
La science politique en quête de légitimité
La deuxième partie (p.101-158), sur la science politique, prolonge cette réflexion en interrogeant la légitimité et le statut d’une discipline qui a eu du mal à s’imposer en Occident et qui est souvent mal comprise dans les sciences sociales, en tant que « science ». Car il est difficile de déterminer les « faits politiques » par rapport aux autres faits sociaux, économiques, culturels, religieux, etc, (p.116 et ss.), et parce que la politique, comme il le dit en se référant à Max Weber, est une science de « la causalité adéquate » et non de la « causalité nécessaire », et parce que la science politique est une « science des régularités non nécessaires, non nomothétiques » (p.132 et ss.). Cette science politique peine encore à trouver ses marques dans l’espace académique tunisien. L’auteur retrace avec précision les grandes étapes de la constitution de la science politique moderne en Occident, avant d’analyser sa non-reconnaissance en Tunisie. Il y dénonce la tutelle politique, l’absence de structures d’enseignement, mais aussi le désintérêt des chercheurs pour un savoir jugé trop subversif. Le diagnostic est sévère, mais il se double d’un plaidoyer approprié pour la création en Tunisie d’un véritable établissement dédié à la science politique, capable de former une culture critique et citoyenne, et d’initier les acteurs politiques et associatifs eux-mêmes (p.139-155). Cette partie confère au livre une dimension institutionnelle et civique, où la science politique n’est plus un luxe académique, mais une nécessité démocratique (débat).
La théorie politique : produire du sens pour agir
La troisième partie (p.159-228), enfin, élève la réflexion au niveau de la théorie politique. M’rad y examine la pluralité des types de théorisation -déontologiques, conséquentialistes, contractualistes, universalistes, contextualistes, explicatives, normatives, interprétatives ou critiques – en insistant sur le rôle de la théorie comme médiation entre la connaissance et l’action. La théorie politique, écrit-il, ne se contente pas de décrire le réel, elle produit du sens, critique l’ordre existant et ouvre la voie à une réconciliation entre le savoir et la pratique (p.205-215). L’auteur rend hommage à la diversité des traditions intellectuelles, de la philosophie politique à la sociologie, et défend une approche pluraliste où le désaccord n’est pas une faiblesse, mais une richesse constitutive du politique.
Ce vaste parcours intellectuel témoigne d’une maîtrise conceptuelle et d’une volonté de refonder la réflexion politique sur des bases solides. L’écriture, dense mais claire, conjugue la rigueur du chercheur et la passion du penseur. On pourra apprécier aussi les confrontations théoriques des auteurs et philosophes que Hatem M’rad met en scène (Rawls, Habermas, Aron, Strauss, Mouffe, Arendt), qui renforcent d’ailleurs sa position pluraliste.
De la politique. Concept, science et théorie n’est pas un manuel, ni un essai académique, c’est un manifeste intellectuel pour une réhabilitation de la politique comme activité humaine essentielle. En plaçant la réflexion sur la politique au cœur du débat scientifique et civique, Hatem M’rad rappelle que penser la politique, c’est déjà un acte politique. Ce livre marque ainsi une étape importante dans la constitution d’une véritable pensée politique tunisienne contemporaine, capable de dialoguer avec le monde tout en restant attentive à ses propres défis.
*Haytham Jarboui – Enseignant-chercheur en littérature française et en science politique
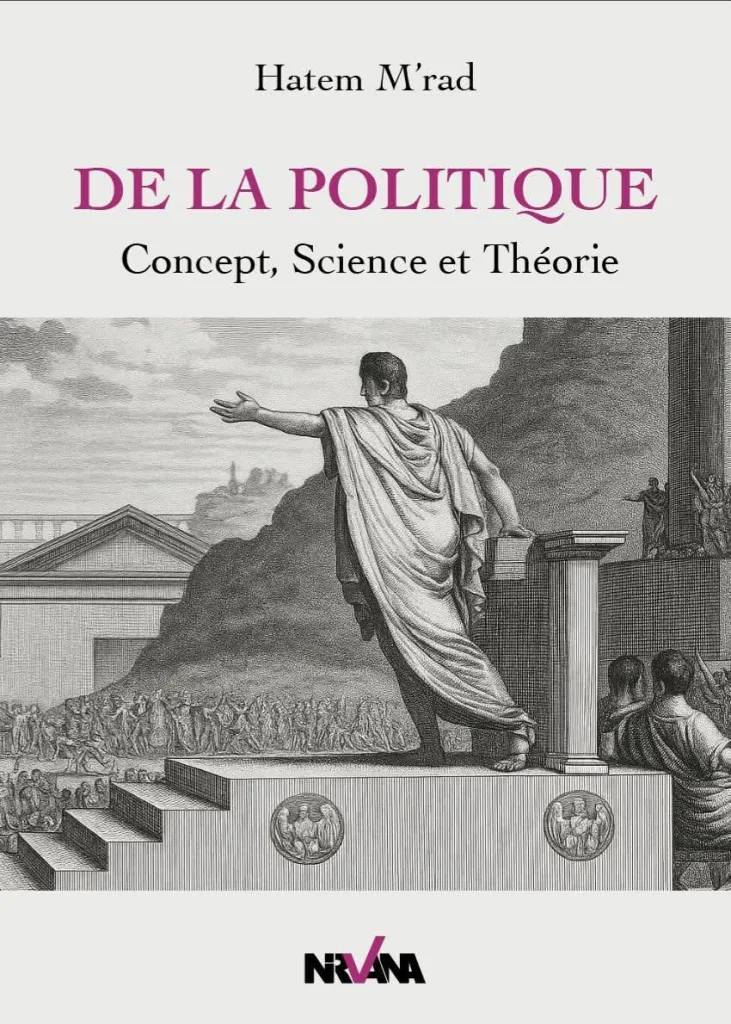







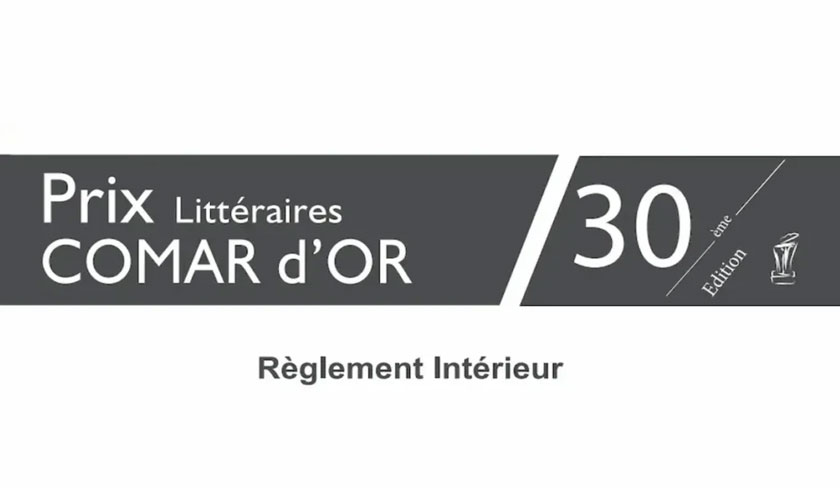



Commentaire
Gg
J’avoue être très méfiant vis à vis des concepts énoncés, parce qu’il y manque, à mon humble avis, l’essentiel: les motivations des acteurs politiques.
Qu’est-ce qui pousse un homme, une femme à « entrer en politique »?
Le désir altruiste de servir ses semblables, son pays?
Oui, bien sûr, en tous cas on l’espère, mais pas seulement, car on peut servir autrement.
C’est là qu’intervient l’ego. Le besoin narcissique d’occuper une position dominante dans le groupe. L’image que l’on a ou veut donner de soi, et pire encore: le dessein caché de servir ses propres intérêts -sa fortune, son entreprise, sa famille.
Si bien que la politique, encore une fois à mon avis, ne saurait être une science avec ce que cela suppose de prédictif, de modélisable.
Il manque l’approche psychanalytique, au moins aussi importante que les concepts.