Ils paient, investissent, emploient… et sont pourtant montrés du doigt. Selon une étude de l’IACE, les entreprises privées assurent près de 53 % des recettes fiscales de l’État tunisien. Mais dans un climat idéologique hostile à la réussite économique, ce sont elles qui sont diabolisées et réprimées, pendant que des entreprises publiques déficitaires, opaques et intouchables poursuivent leur lente déliquescence. Derrière cette contradiction se dessine un modèle économique archaïque défendu par un régime qui refuse toute idée de privatisation et s’acharne sur ceux qui le financent.
Ils sont invisibles dans le discours politique, mais omniprésents dans les caisses de l’État. À contre-courant de la rhétorique officielle, une étude de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) publiée jeudi 29 janvier 2026 vient rappeler une vérité que le pouvoir préfère taire : le financement de l’État tunisien repose avant tout sur le secteur privé. Non pas sur une multitude d’acteurs, mais sur un noyau restreint d’entreprises structurées, organisées, déclarantes — et donc exposées.
Selon l’étude, près de 53 % des recettes fiscales de l’État proviennent directement ou indirectement des entreprises privées. Impôt sur les sociétés, TVA collectée, impôt sur le revenu prélevé à la source sur les salaires : un dinar fiscal sur deux est généré par l’activité privée. Cette contribution massive se fait sans privilège, sans traitement de faveur, et bien souvent sous une pression croissante.
Le mythe des 800.000 entreprises
Dans le débat public, le chiffre de plus de 800.000 entreprises est régulièrement brandi pour relativiser l’effort du secteur privé ou justifier une politique fiscale agressive. L’étude de l’IACE démonte ce raisonnement avec rigueur. Sur plus de 800.000 unités économiques recensées, seules environ 170.000 sont réellement structurées et identifiées comme actives sur le plan fiscal. Et parmi elles, à peine 103.756 déposent effectivement une déclaration fiscale annuelle.
Le reste relève majoritairement de l’auto-emploi, du travail indépendant, d’activités sans salariés, souvent irrégulières, parfois informelles. Numériquement abondant, ce tissu économique est fiscalement marginal. La base imposable réelle de l’État est donc étroite, concentrée et parfaitement identifiable.
Ceux qui paient sont aussi ceux qui produisent
Ce noyau réduit d’entreprises structurées n’est pas seulement le principal contributeur fiscal. Il constitue le cœur productif du pays. Ces entreprises assurent 43% de l’emploi formel, près de 60% de la valeur ajoutée nationale et près de 80 % de l’investissement total. Elles créent de la richesse, emploient, exportent, innovent et maintiennent une économie formelle à flot.
Pourtant, ce sont précisément ces entreprises qui concentrent l’attention de l’administration fiscale, des corps de contrôle et, de plus en plus, de l’appareil répressif de l’État. Moins il y a d’entreprises déclarantes, plus la pression fiscale se concentre sur celles qui restent. Le nombre de déclarants recule, mais les montants déclarés augmentent. La charge fiscale devient plus lourde, plus ciblée, plus difficilement soutenable.
Une répression sélective
Dans la Tunisie de Kaïs Saïed, la réussite entrepreneuriale est rarement valorisée. Elle est souvent suspecte et diabolisée. Les redressements fiscaux, les poursuites judiciaires, les incarcérations d’hommes d’affaires ne frappent pas l’informel, ni les micro-structures invisibles. Ils visent presque exclusivement les entreprises structurées, celles qui ont pignon sur rue, des salariés, une comptabilité, une traçabilité.
L’État ne s’attaque pas à ceux qui échappent au système. Il s’acharne sur ceux qui y participent. Une stratégie à court terme, politiquement rentable dans un climat populiste, mais économiquement suicidaire.
Le contraste accablant avec le secteur public
L’étude de l’IACE met en lumière un autre paradoxe majeur. Tandis que le secteur privé finance l’État, les entreprises publiques continuent de peser lourdement sur les finances publiques. Leur déficit annuel moyen dépasse 2,3 milliards de dinars, soit 22 % du déficit budgétaire total.
Plus grave encore, alors que l’État multiplie les exigences administratives, fiscales et bureaucratiques à l’égard des entreprises privées, il tolère sans difficulté l’opacité chronique des entreprises publiques. Beaucoup d’entre elles ne publient ni leurs états financiers, ni les rapports de leurs commissaires aux comptes. Cette situation concerne même des entreprises publiques cotées en Bourse, soumises en théorie aux mêmes obligations de transparence que les sociétés privées.
Le contraste est saisissant. Le Conseil du marché financier, gendarme de la place boursière, épingle systématiquement les retards de publication des entreprises privées, allant jusqu’à suspendre leur cotation. Dans le même temps, il accepte sans broncher des retards de plusieurs années dans la publication des comptes des entreprises publiques. Deux poids, deux mesures, institutionnalisés.
Malgré ce coût colossal et cette absence flagrante de discipline, le régime refuse toute réflexion sérieuse sur la privatisation, la restructuration ou l’ouverture du capital de ces entreprises. L’idéologie prime sur l’efficacité économique. Des structures publiques chroniquement déficitaires sont maintenues artificiellement en vie, absorbant des ressources qui pourraient être allouées à l’investissement productif, à l’éducation ou à la santé.
En clair, le privé finance, le public plombe.
L’ingratitude comme politique économique
Le message envoyé aux entrepreneurs est profondément dissuasif : créez de la richesse, mais ne vous attendez ni à la reconnaissance ni à la protection. L’État se comporte en percepteur dur et en juge soupçonneux, jamais en partenaire. Cette diabolisation permanente du secteur privé traduit une vision archaïque de l’économie, où la création de richesse est assimilée à une faute morale.
Or, aucun pays ne s’est développé durablement en traitant ses principaux contributeurs comme des adversaires. En pressurant toujours les mêmes, l’État tunisien fragilise la base même de son financement, décourage la formalisation, alimente l’informel et assèche l’investissement.
Un modèle à bout de souffle
Le constat dressé par l’étude de l’IACE dépasse largement la question fiscale. Il révèle un modèle économique arrivé à saturation, incapable de se renouveler et dangereusement dépendant d’un nombre toujours plus réduit d’acteurs privés. En concentrant l’essentiel de la charge budgétaire sur un noyau étroit d’entreprises structurées, l’État tunisien ne fait pas que créer une injustice : il fragilise mécaniquement ses propres fondations.
Car ce modèle repose sur une contradiction centrale. D’un côté, l’État a besoin du secteur privé pour financer son budget, ses dépenses sociales et ses entreprises publiques déficitaires. De l’autre, il refuse de reconnaître ce secteur privé comme un partenaire légitime du développement économique. Il le tolère comme une vache à lait, mais le combat comme une force politique, sociale et symbolique.
À force de pression fiscale, de contrôles tatillons, de soupçon généralisé et de discours stigmatisants, l’État décourage la formalisation qu’il prétend appeler de ses vœux. Il envoie un signal clair aux entrepreneurs : mieux vaut rester petit, invisible, fragmenté, que structuré, déclaré et exposé. Le résultat est connu. L’informel prospère, l’investissement ralentit, la prise de risque recule et la base fiscale se contracte encore davantage.
Le paradoxe est cruel. Plus l’État frappe les entreprises structurées, plus il réduit leur nombre. Et plus leur nombre diminue, plus la charge fiscale qui pèse sur celles qui restent devient insoutenable. C’est un cercle vicieux parfaitement documenté, mais politiquement ignoré. À court terme, la répression rapporte. À moyen terme, elle assèche. À long terme, elle ruine.
L’idéologie au détriment du pragmatisme
Ce modèle est d’autant plus intenable qu’il s’accompagne d’un refus obstiné de réformer le secteur public. Kaïs Saïed l’a martelé très souvent, il refuse catégoriquement de privatiser les entreprises publiques qu’il considère comme le « joyau » de la nation. Des joyaux inutiles et budgétivores.
Pendant ce temps-là, les entreprises privées sont sommées de se justifier, de payer et de se taire, alors que les entreprises publiques déficitaires continuent d’absorber des milliards sans obligation de résultat. L’État exige la performance de ceux qu’il taxe, mais tolère l’échec de ceux qu’il possède.
Il ne s’agit plus d’un débat idéologique entre État et marché. Il s’agit d’un choix de survie économique. Aucun pays ne peut durablement financer un État obèse, un secteur public déficitaire et une politique sociale dispendieuse en pressurant toujours les mêmes acteurs productifs. Aucun système ne tient longtemps quand ceux qui créent la richesse sont traités comme des suspects permanents.
Le secteur privé tunisien finance déjà l’État. Il finance son budget, ses déficits et parfois même ses erreurs.
Mais un État qui vit de ceux qu’il réprime finit toujours par les faire fuir, se taire ou disparaître.
Et quand il n’y aura plus que des entreprises invisibles, informelles et non contributrices, il ne restera plus à l’État qu’une certitude : on ne gouverne pas longtemps un pays en punissant ceux qui le font vivre.
Maya Bouallégui




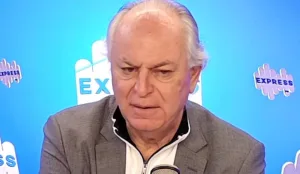










3 commentaires
BTA Mejid
Encore un article interessant, MB chapeau, vous n’avez pas tout dit. D’autres secteurs doivent etre screenés. Toutes ou presque les entreprises publiques sont deficitaires ( et pas obligées de présenter leur bilan: quelle honte).
Les banquiers prêtent à l’etat pour boucler son budget et payer les fonctionnaires, le privé n’obtient pas de credit ( en 2025 baisse des credits de 40%). Il n’y a pas que les petites entreprises qui ne payent pas d’impot, le commerce parallele est un electron libre. Culpabiliser les riches , le populisme, la terreur de la justice, aucun projet, aucune vision, des institutions d’etat intransigentes et imprévisibles . Tous ces ingrédients font fuir les vrais entrepreneurs ( industriel , high tech, commerçant , agriculteur, service, immobilier..) et les jeunes qui perdent espoir en quittant le pays. Alors continuez à culpabiliser les riches, dans quelques années on sera tous zwewlas à se bouffer entre nous, puisqu’il n’y a plus rien à manger.
A4
Si tu as de l’argent, c’est que tu es un voleur !
Si tu as réussi, c’est que tu es un tricheur !
Signé: un pauvre raté …
Hannibal
C’est l’idéologie à deux millimes Issue du blablatage des cafés tels que celui d’El Mnihla.
On y considère l’entrepreneur comme voleur et on y oublie que c’est la vache à lait.