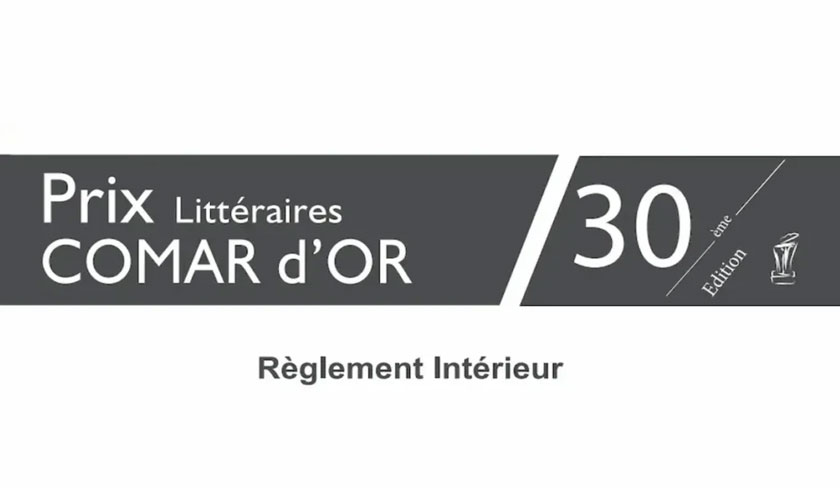Par Saïma Mezoughi*
En pénétrant dans le bureau de presse du Salon international du livre de Tunis pour obtenir mon badge de journaliste, je fus frappée par une vision inattendue : des centaines de badges alignés, tous estampillés « journaliste culturel ».
Ce spectacle m’a interpellée. Qui sont ces journalistes culturels ? Où sont leurs voix dans le paysage médiatique ? Leur présence est-elle palpable au-delà de ces morceaux de plastique ?
Le rôle essentiel du journaliste culturel
Il semble que le journalisme culturel ait été réduit à une formalité, une étiquette sans substance. Peu nombreux sont ceux qui s’engagent réellement, qui questionnent, qui dérangent. La majorité semble se contenter d’une présence passive, évitant les sujets qui fâchent, les débats qui dérangent.
Le rôle du journaliste culturel ne devrait pas se limiter à la couverture d’événements ou à la promotion d’œuvres. Il devrait être un acteur critique, un observateur engagé, un défenseur de la liberté d’expression. Pourtant, nous écrivons sur les salons du livre, sur les vernissages de galeries, mais nous nous taisons lorsqu’un poète est exclu ou lorsqu’une pièce de théâtre est censurée. Est-ce la peur qui nous paralyse ? Ou sommes-nous tout simplement indifférents ?
Le vide conceptuel qui entoure la définition même de « journaliste culturel » est alarmant. Assister à une signature suffit-il à faire du journalisme ? Qu’en est-il de l’analyse des contenus, de la déconstruction des discours, de l’interrogation des structures culturelles elles-mêmes ?
Silence face aux censures : une complicité passive ?
Le silence de ces journalistes face aux censures, aux reports d’événements, à la marginalisation de certaines œuvres est préoccupant. Il reflète une forme de complicité passive, un renoncement à la mission première du journalisme : informer, questionner, éveiller les consciences.
Car la censure n’est pas toujours un décret officiel ; elle peut être un pacte silencieux entre la peur et l’intérêt. Et dans ce pacte, que faisons-nous, journalistes ? Où nous situons-nous ?
Comme le soulignait Michel Foucault, le pouvoir s’exerce souvent à travers des silences imposés, des non-dits. Antonio Gramsci, quant à lui, insistait sur le rôle de l’intellectuel organique, celui qui s’engage activement dans les luttes sociales et culturelles. Jürgen Habermas évoquait l’importance de l’espace public comme lieu de débat et de formation de l’opinion.
Redéfinir le journalisme culturel en Tunisie
Et pourtant, en Tunisie, cet espace semble se rétrécir, étouffé par une uniformité médiatique, une autocensure rampante. Le journaliste culturel, au lieu d’être un éclaireur, devient un spectateur silencieux, voire un complice involontaire de cette régression.
Le devoir d’un intellectuel, disait Sartre, est de dire la vérité, même quand elle dérange. À plus forte raison lorsqu’il est journaliste.
Il est temps de redéfinir le rôle du journaliste culturel, de raviver sa flamme critique, de lui redonner sa voix. Car sans cette voix, la culture risque de devenir un simple produit de consommation, vidé de sa substance.
*Journaliste