Par Mohamed Salah Ben Ammar*
Ils sont là, dans la cour d’école. Immobiles. Silencieux. Un moment de prière à Hammamet, capturé en photo. Rien de très banal. Sauf que cette image est un mensonge. Elle ne montre pas la foi triomphante, mais la fragilité d’une jeunesse qui se raccroche à ce qu’elle peut. La religion n’est plus ici un dogme,mais un radeau. Le dernier îlot de sens dans un océan de désillusions.
Les faits, d’abord
L’effondrement du mur d’une école à Mazouna en 2023 a bien eu lieu, causant la mort de trois élèves. Un drame qui a scandalisé la Tunisie, un souvenir douloureux toujours vivace qui symbolise l’état de délabrement de certains établissements. La « harga » – l’émigration clandestine – est, elle, une hémorragie. Les chiffres des organisations tunisiennes et internationales (comme le FTDES) le confirment : des milliers de mineurs, seuls ou en famille, tentent chaque année la traversée. Leur vie est un pari. L’inconnu de la mer semble préférable à la certitude du désespoir.
La prière comme soupir
Dans ce contexte, se recueillir n’est pas qu’un rite. C’est un acte de résistance. Une minute de grâce où le monde extérieur, avec ses murs qui croulent et ses horizons bouchés, est tenu à distance. La foi devient un point fixe dans un univers qui tangue. Mais c’est un refuge de papier. Sa fragilité est le miroir de celle qui le pratique.
L’école, champ de bataille
L’école tunisienne est le microcosme de toutes les tensions. Pour certains, la prière est une bouffée d’oxygène, une parenthèse de dignité. Pour d’autres, elle est un rappel des normes sociales qui étouffent. Et pour ceux qui n’y trouvent aucun réconfort, les issues sont tragiques : le mur qui s’écroule, la barque qui tangue, la disparition lors d’une compétition à l’étranger. Ces « évanouissements » d’athlètes, régulièrement rapportés par la presse, sont les fuites silencieuses d’une génération qui ne voit plus d’avenir chez elle.
Le paradoxe salvateur
Alors, que faire de ce moment de prière ? L’interdire, ce serait nier une détresse. L’imposer, ce serait trahir la liberté de conscience. La solution est peut-être dans ce paradoxe : en faire un temps facultatif et encadré. Un espace où l’on apprendrait, justement, le respect de l’autre. Où celui qui prie côtoie celui qui se tait, et où chacun est invité à réfléchir. La religion deviendrait alors un outil pour apprivoiser le chaos, et non pour l’ignorer.
La leçon
Cette cour d’école à Hammamet nous parle bien au-delà de la Tunisie. Elle nous rappelle une vérité universelle : quand les institutions et les promesses s’effritent, l’humain cherche désespérément du sens. Il le trouve dans la foi, dans la fuite ou dans le silence.
La vraie question n’est pas de savoir s’il faut autoriser la prière. C’est de se demander pourquoi elle est devenue si urgente, si vitale. Pourquoi une jeunesse préfère-t-elle affronter les vagues plutôt que de rester sur la terre ferme ?
Construire des écoles où les murs ne tombent pas et où les esprits peuvent s’élever : voilà la prière la plus forte que l’on puisse offrir à ces enfants. Le reste n’est que bruit, un bruit qui couvre le son terrible du silence d’une génération entière.
* Pr Mohamed Salah Ben Ammar MD – MBA







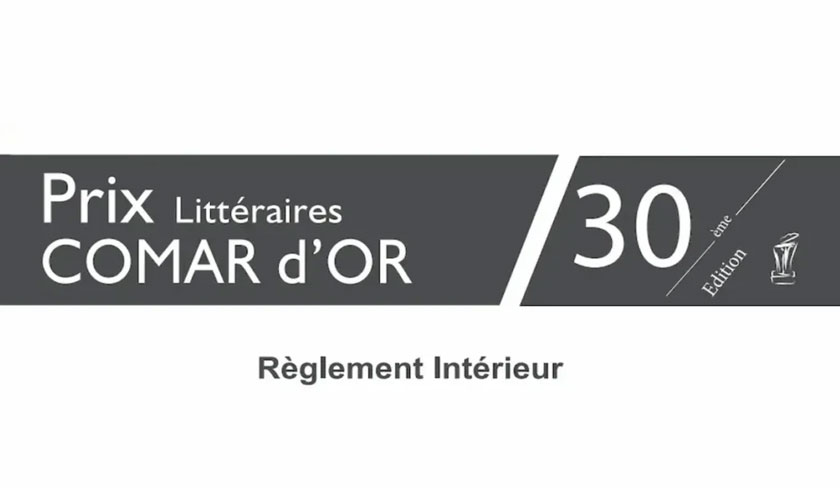



2 commentaires
HOUDA
Test
HOUDA
Test