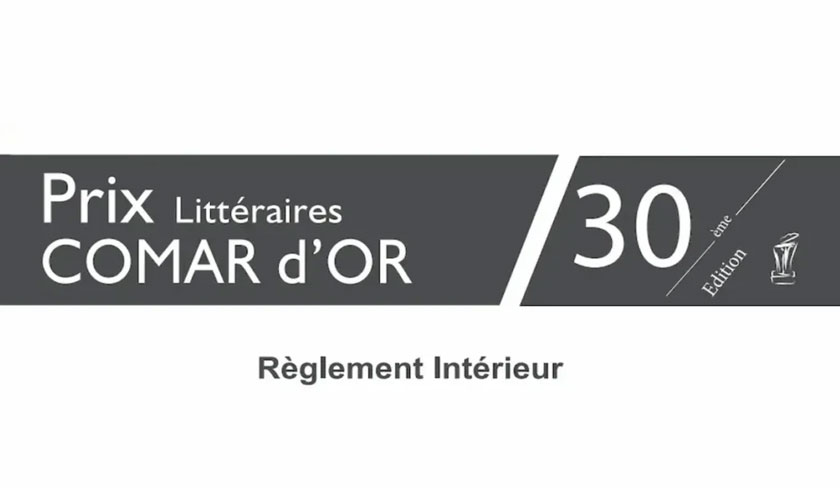Par Ilyes Bellagha*
Notre identité, fragilisée par la déculturation et par le regard importé d’Occident, n’est pas condamnée. Elle possède en elle une mémoire critique puissante – de Ibn Khaldoun à Mahmoud Messaïdi – qui peut rallumer le feu. Encore faut-il que nos intellectuels sortent des salons et redécouvrent la vitalité du terrain.
Une identité malade de déculturation
Notre identité souffre. Elle est souvent traitée comme un objet d’étude extérieure, sous un regard figé. Les élites académiques, formées dans les universités occidentales, reviennent avec deux biais :
– Le conservatisme : reproduire les maîtres étrangers, comme si la pensée se limitait à la récitation.
– L’orientalisme intériorisé : reprendre l’attitude née avec Napoléon Ier, quand l’Orient fut transformé en curiosité coloniale.
(En clair : nos intellectuels se contentent soit de répéter les théories apprises ailleurs, soit de regarder leur propre société comme un musée exotique.)
À force, l’identité devient un mot abstrait, brandi dans les colloques mais absent des rues.
Nos ressources critiques : d’Ibn Khaldoun à Mahmoud Messaïdi
Mais cette identité, même affaiblie, garde en elle des braises. Ibn Khaldoun, au XIVᵉ siècle, nous a appris à penser l’histoire comme une dynamique sociale.
(Vulgarisation : il a montré que les peuples font l’histoire par leurs forces collectives, pas seulement par la volonté des rois ou des dieux.)
Plus près de nous, Mahmoud Messaïdi, écrivain et penseur tunisien du XXᵉ siècle, a raconté dans ses romans (Mawlid al-Nisyan, al-Sudd) les contradictions de l’homme arabe moderne.
(Vulgarisation : il a mis en scène la tension entre fidélité à nos racines et désir de modernité.)
Ces voix rappellent que nous avons une tradition critique propre, capable de faire vibrer l’identité de l’intérieur.
L’universel comme échafaudage, pas comme noyau
S’ouvrir à l’universel est nécessaire. Mais pas avant d’avoir affirmé nos propres références. Trop souvent, on place Bourdieu ou Badiou au centre, et on relègue Ibn Khaldoun ou Messaïdi en marge.
– L’habitus de Bourdieu peut nous éclairer : il désigne l’ensemble des réflexes et habitudes qu’on intègre dans la vie sociale.
(Exemple : on se tient, on parle, on pense d’une certaine façon sans même réfléchir, parce qu’on l’a appris dans sa famille, son école, son milieu.)
– La méthode créative de Badiou insiste sur l’événement comme rupture porteuse de vérité.
(Exemple : une révolution ou une mobilisation citoyenne qui change la donne et oblige à inventer du nouveau.)
Ces outils sont précieux. Mais ils doivent rester des appuis, pas le noyau. Notre centre de gravité doit rester ancré dans nos propres penseurs.
Réconcilier théorie et terrain
Entre la société qui vit ses métamorphoses – dans les cafés, les quartiers, les réseaux sociaux – et les intellectuels enfermés dans leurs références étrangères, le fossé se creuse. Pourtant, la tâche de l’intellectuel n’est pas de recopier des cadres importés, mais d’écouter la rumeur du peuple et de la mettre en dialogue avec les savoirs.
C’est dans cette confrontation que l’identité peut redevenir un projet vivant, plutôt qu’un mot confisqué.
Avec ce travail, les urbanistes, les architectes et tous les créateurs d’espaces citoyens ne se permettront plus de vaguer. Ils auront à assumer que chaque rue, chaque place, chaque bâtiment est porteur d’identité. L’espace public n’est pas neutre : il est un miroir de la culture, de la mémoire et du futur d’une société.
(En vulgarisation : quand on construit une place ou un quartier, on ne dessine pas seulement des murs ou des trottoirs, on façonne aussi la manière dont les citoyens se reconnaissent, se croisent et se sentent appartenir à une communauté.)
Conclusion
Notre identité n’a pas besoin de gardiens de musée. Elle a besoin d’arpenteurs du terrain. Oui, elle est malade de déculturation, mais dans ses sursauts elle garde la force de rallumer le feu. Si nous redécouvrons le regard critique d’Ibn Khaldoun, si nous faisons résonner les écritures de Messaïdi, alors seulement l’échafaudage de Bourdieu ou de Badiou pourra renforcer notre maison. Mais il ne faut jamais inverser l’ordre : d’abord le noyau, ensuite l’universel.
*Architecte