Par Ilyes Bellagha*
L’identité tunisienne ne se dit pas, elle se cherche.
Entre la fidélité et la trahison, entre la mémoire et la peur d’habiter,
nous avons fait de la confusion un art national.
Ce texte interroge cette identité mouvante, entre Histoire et non-culture,
où même le mot “Inchallah” devient miroir de notre rapport au monde.
Le magma des origines
L’identité tunisienne n’est pas une addition d’origines, mais une fécondation. Amazighe, arabe, ottomane, andalouse — elle se nourrit de toutes ces racines, mais reste en fusion. Comme le premier article de la Constitution, elle nomme avant de comprendre. Ce magma intérieur féconde notre être collectif : il nous habite plus qu’il ne nous définit.
La fidélité et le paradoxe du « oui mais non »
En dehors du débat, nous sommes tous tunisiens — par fidélité. Mais dès qu’on se parle, surgit le oui mais non, ce paradoxe plus expressif que la négation. L’identité devient tension : entre reconnaissance et méfiance, entre union proclamée et confiance refusée. La tunisianité, c’est cet entre-deux où l’on veut appartenir sans se livrer.
La CIN et l’ʿAsabiyya : du lien à la suspicion
La carte d’identité nationale — la fameuse CIN — prétend représenter le citoyen, mais ne fait que l’immatriculer. Elle consigne l’appartenance, sans garantir la reconnaissance. Dans la logique d’Ibn Khaldoun, la ʿasabiyya (solidarité) devient ici soupçon : appartenir, c’est déjà risquer d’être mis en cause. La fraternité se transforme en fichier ; la citoyenneté en preuve de loyauté.
L’histoire contre la géographie
Nous confondons identité et territoire. Pourtant, être tunisien, c’est appartenir à une Histoire, pas à une géographie. Nous avons remplacé la géopolitique du réel par une géopolitique du mythe : de l’Irak à l’Andalousie, de la rivière à la mer. Ce fil d’or relie les ruines, mais il ne relie plus les vivants. L’identité devient récit, et non carte.
Carthage, ou la non-fidélité partagée
Par non-fidélité à ceux qui partagent, nous nous proclamons Carthaginois. Non par héritage, mais par refuge. Carthage devient la nostalgie commune de ceux qui ne croient plus au commun. Elle offre une grandeur de substitution, un mythe pour masquer le présent. Être Carthaginois, c’est refuser d’être contemporain.
L’architecture, ou la trace confuse de l’identité
La conception même de cette trace — cette empreinte qu’on appelle « identité » — trouble notre architecture. Nos villes ne savent plus si elles doivent naître ou s’écraser. Elles oscillent entre le désir de renaissance et la peur de disparaître, entre l’appel du neuf et la nostalgie du révolu. Construire, ici, c’est toujours répondre à une question d’identité. Et quand cette identité se brouille, l’architecture devient hésitation. Le geste se fige, la main tremble, la pierre doute.
Le bruit et le texte
Ce qui définit notre culture, c’est cette non-culture : un bruit, non un texte structuré. Le bruit, c’est ce qui reste quand la parole se dissout, quand la mémoire n’a plus de syntaxe. La culture tunisienne n’est pas absente : elle est confuse, c’est-à-dire vivante dans le désordre. Ce bruit, pourtant, n’est pas vain. Il est la respiration du peuple quand les institutions n’écrivent plus.
La peur bleue de la structure
Nous avons été les fondateurs de Facebook avant même que Facebook ne naisse. Dans nos cafés, nos places, nos ruelles, tout y était déjà : les statuts murmurés, les partages d’humeur. Et pourtant, aujourd’hui, nous avons une peur bleue de l’intelligence artificielle — non parce qu’elle serait trop intelligente, mais parce qu’elle est une structure. Ce que nous redoutons, c’est le miroir qu’elle nous tend : celui d’une société qui refuse encore d’assumer sa propre complexité.
Le code trahi
En Tunisie, tout ce qui relève du code — qu’il soit économique, juridique ou routier — semble voué à être contourné. Non pas par esprit de liberté, mais par habitude de trahison. La transgression n’est plus un acte de résistance : elle est devenue réflexe collectif. Nous ne vivons plus le dilemme de Shakespeare — to be or not to be — mais une forme plus perverse : laisse faire, laisse aller. Le paradoxe tunisien n’est plus celui de l’être, mais du contournement rouspecté : désobéir sans révolutionner, se plaindre sans construire, dénoncer sans réparer.
Vers un peuple qui tente sans vraiment vouloir d’habiter
Nous tentons sans vraiment vouloir. Nous parlons d’avenir sans l’habiter, de changement sans l’incarner. Notre peuple avance à tâtons, non par manque d’intelligence, mais par peur d’habiter ce qu’il crée. Habiter exige du courage : celui de s’enraciner sans se figer. Mais notre réflexe national, c’est le Inchallah — mot splendide, devenu paresseux. S’il redevenait devise, non souhait, il signifierait : non pas « que Dieu le veuille à ma place », mais « que le sens advienne à travers mon acte ».
*Ilyes Bellagha – Architecte ITAAUT – Temple du Sens, Tunis 2025








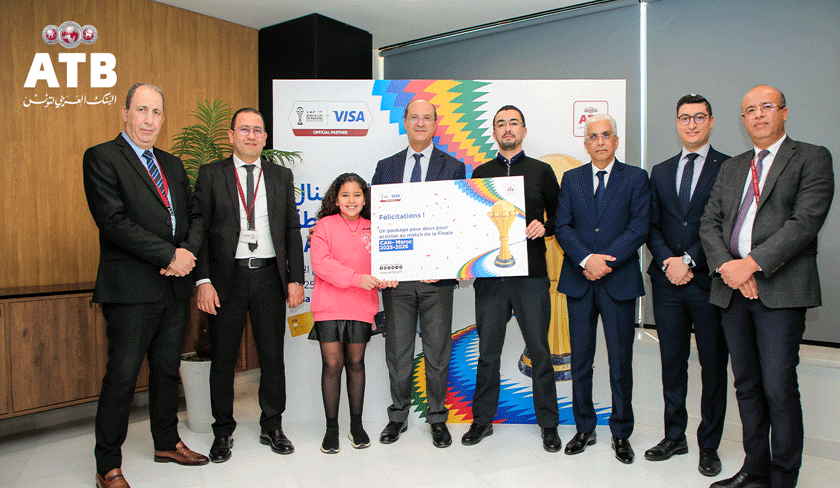


2 commentaires
HatemC
HISTORIQUEMENT VOTRE
Constat Amer
En Tunisie, l’histoire a souvent été “réécrite” pour fabriquer un récit national valorisant, surtout après 1956.
Ce n’est pas unique : toutes les nations modernes ont construit des mythes fondateurs.
Mais en Tunisie, cette mythologie identitaire a remplacé une vraie lecture historique.
Après l’indépendance, le régime de Bourguiba devait unifier un peuple très divers (urbains, tribus, côtiers, intérieurs, berbères, etc.).
Pour y parvenir, il a inventé une continuité symbolique :
“De Carthage à la Tunisie moderne” — comme si Hannibal, Ibn Khaldoun et Bourguiba appartenaient à la même lignée nationale.
En réalité, Carthage a été détruite, Ibn Khaldoun vivait dans un monde islamique sans notion de nation, et la Tunisie moderne est une création du XIXᵉ siècle.
Une histoire enseignée de manière sélective
L’école tunisienne glorifie Carthage et l’indépendance, mais passe vite sur :
– Les 13 siècles de domination étrangère (romaine, arabe, ottomane, française) ;
– La disparition des populations autochtones (berbères romanisés, judaïsés, arabisés) ;
– Le rôle tardif des idées venues d’Europe dans la formation du sentiment national.
Résultat : beaucoup de Tunisiens croient à une “nation éternelle”, alors qu’il s’agit d’une construction récente.
Une amnésie identitaire
– On confond territoire ancien et nation ancienne.
– On s’approprie des civilisations disparues (comme Carthage) pour combler le vide historique.
– Et on occulte les héritages multiples : arabe, berbère, ottoman, méditerranéen, africain.
En conclusion
Les Tunisiens n’ont pas à rougir de leur histoire.
Mais ils doivent la connaître telle qu’elle est, pas telle qu’elle a été réécrite pour flatter une identité imaginaire.
Comprendre que la Tunisie moderne est une création politique récente — née au XIXᵉ siècle — n’est pas un affront :
c’est au contraire le point de départ d’une conscience historique adulte.
HatemC
HISTORIQUEMENT VOTRE
La Tunisie a une histoire très ancienne, mais la nation tunisienne est une création moderne. NUANCE, cessez de vous gargariser avec » nous sommes un peuple vieux de 3000 ans » c’est FAUX
LA TERRE TUNISIENNE A PLUS DE 3 000 ANS D’HISTOIRE, MAIS LA NATION TUNISIENNE N’A QU’ENVIRON 70 ANS D’EXISTANCE
Avant le XIXᵉ siècle, il n’existait pas de nation tunisienne au sens moderne (avec sentiment national, institutions centralisées, frontières fixes et identité commune partagée).
Ce qu’il y avait :
Des populations Berbères, Arabes, Andalous, Turcs, Juifs, Noirs africains… qui vivaient sur ce territoire, mais sans se définir comme « Tunisiens »
Le basculement s’opère
À partir du XIXᵉ siècle, avec les réformes de Ahmed Bey, Kheireddine Pacha, la Constitution de 1861, et surtout l’arrivée du protectorat français (1881), une conscience collective émerge :
→ défense du territoire face à l’occupant
→ affirmation d’une spécificité culturelle et politique
→ naissance de l’idée nationale tunisienne.
C’est donc la colonisation française qui a paradoxalement contribué à « cristalliser » une identité tunisienne moderne.
Ce n’est qu’au XIXe siècle, avec les réformes huseynites (Ahd al-Aman de 1857, Constitution de 1861), puis la colonisation française (1881), que naît progressivement une conscience nationale tunisienne moderne — en réaction à la domination étrangère…. ça fait mal …
Beaucoup de Tunisiens ont besoin de se rattacher à une histoire longue et glorieuse, surtout après des siècles de domination. C’est une façon de réaffirmer une fierté collective.
Le TERRITOIRE de la Tunisie a bel et bien 3 000 ans d’histoire :
Carthage, Rome, Kairouan, les dynasties hafsides, etc.
Cette terre a toujours été un carrefour de civilisations, un lieu stratégique et fertile, au cœur de la Méditerranée.
Donc oui, l’histoire de la Tunisie est millénaire.
Mais LE PEUPLE TUNISIEN en tant que “nation” unifiée est une construction récente (XIXᵉ-XXᵉ siècle).
Les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Ottomans, les Français : chacun a dominé, influencé, ou transformé cette terre.
Les habitants n’avaient pas conscience d’appartenir à une même entité politique ou nationale.
C’est seulement avec la colonisation, puis le mouvement national, qu’est née l’idée de « nous, les Tunisiens ».
Autre mythe identitaire très répandu, mais historiquement FAUX ou, du moins, très simplifié.
Carthage n’était pas “tunisienne”
Carthage a été fondée vers le 9ᵉ siècle av. J.-C. par des Phéniciens venus de Tyr (actuel Liban).
C’était une civilisation étrangère installée sur le territoire actuel de la Tunisie.
Les Carthaginois parlaient le punique (langue sémitique proche de l’hébreu et du phénicien), pas le berbère ni l’arabe.
Les populations locales (Berbères / Libyens) ont été soumis, intégrés ou alliés, mais ils n’étaient pas les maîtres de Carthage.
Au XIXᵉ et XXᵉ siècles, les élites tunisiennes (et le protectorat français) ont récupéré Carthage comme symbole glorieux pour donner une PROFONDEUR HISTORIQUE à la Tunisie moderne.
C’était une INVENTION IDENTITAIRE UTILE : elle permettait de dire “nous avons une histoire de 3 000 ans”, même si la continuité est imaginaire.
En réalité, les Tunisiens actuels sont surtout les héritiers des Berbères arabisés et islamisés, pas des Phéniciens de Tyr.