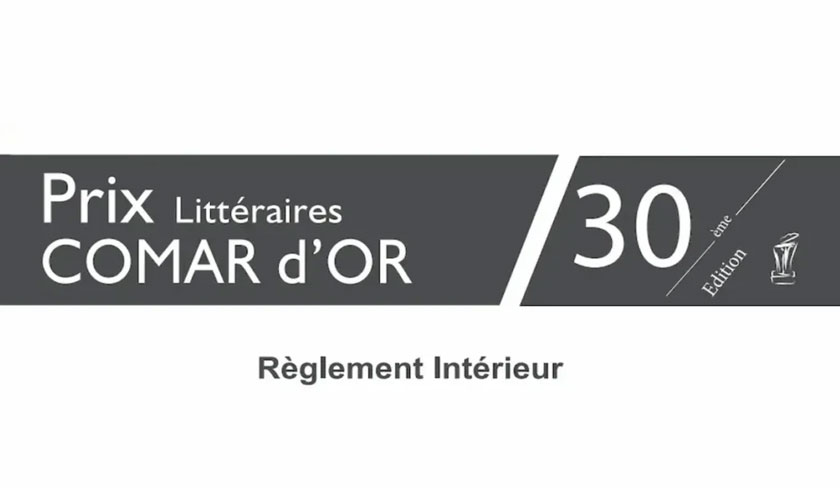Aux alentours de 14 heures, lundi 17 novembre 2025, le procès en appel de l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État » a été suspendu. Le président de la séance a annoncé le report à une nouvelle audience, prévue le 27 novembre 2025. Cette procédure, déjà marquée par des irrégularités dénoncées par la défense et la tenue à distance des audiences, continue de susciter de vives critiques de la part des avocats et des familles des détenus. Retour sur l’essentiel de la journée.
Le procès en appel dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, initialement prévu fin octobre et reporté au 17 novembre 2025, s’est ouvert lundi matin. Cette audience intervient après plusieurs alertes de la défense concernant des irrégularités de procédure ainsi que des demandes répétées pour que les accusés soient présents physiquement.
Un procès sous tension, après des mois d’irrégularités dénoncées
Fait inédit, les journalistes ainsi que des représentants d’ambassades ont été autorisés à assister à la séance sans encombre, rapporte notre consœur de Mosaïque Fm, Amira Mohamed, présente sur place. Une exception notable dans un dossier marqué, depuis des mois, par des restrictions d’accès et de fortes tensions autour de la tenue des audiences.
La séance a débuté par l’appel des détenus, qui ont refusé de comparaître à distance. Les avocats de la défense, ainsi que le bâtonnier Boubaker Bethabet, ont demandé qu’il soit consigné que Jaouhar Ben Mbarek est hospitalisé et non simplement « absent » ou « refusant de comparaître ». Ils ont également sollicité l’accès au document que leur client aurait signé, attestant d’un refus d’assister à l’audience.
Le représentant de l’administration pénitentiaire, intervenant à distance, s’est contenté de déclarer que Jaouhar Ben Mbarek « n’a pas été amené ».
L’état de Jaouhar Ben Mbarek au cœur des alertes de la défense
L’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek a informé la cour que son frère avait été victime de torture, précisant qu’aucune enquête judiciaire n’a été ouverte à ce jour, hormis une enquête administrative menée par l’administration pénitentiaire. Elle a indiqué avoir saisi le procureur général, lequel lui a affirmé avoir transmis la plainte au tribunal de Grombalia, sans qu’elle ne soit encore enregistrée. Elle a rappelé que le crime de torture est imprescriptible.
L’avocat Samir Dilou a annoncé que la plainte pour torture aurait finalement été inscrite ce jour. Il a relevé l’absence de toute mention de l’hospitalisation de Jaouhar Ben Mbarek dans le dossier transmis à la cour, estimant nécessaire de vérifier où se trouvait son client au moment où un « refus de comparaître » a été rapporté.
Selon la défense, Jaouhar Ben Mbarek a été agressé à la prison de Belli par d’autres détenus. Alerté dans le cadre d’un signalement pour torture, un médecin a ordonné son transfert et son hospitalisation à l’hôpital universitaire de Nabeul, où il se trouve actuellement. Des examens médicaux auraient confirmé des contusions et des traces de coups. L’Ordre national des avocats a, de son côté, signalé l’état de Jaouhar Ben Mbarek. Le bâtonnier, Boubaker Bethabet, avait rappelé en octobre qu’aucune déclaration de représentation ne serait déposée tant que les irrégularités signalées par la défense ne seraient pas levées. De son côté, l’administration pénitentiaire conteste l’ensemble des accusations, réfute l’existence d’une grève de la faim et affirme assurer un suivi médical continu des détenus.
Une demande de récusation qui met en cause l’indépendance de la cour
L’avocate Samia Abbou est ensuite intervenue pour déposer une demande de récusation du président de la séance. Elle a informé la cour que son client, Ghazi Chaouachi, a appris par son fils l’existence de « soupçons sérieux » concernant le magistrat qui dirige l’audience, des informations qui auraient même été transmises à l’Inspection générale. Elle a ajouté que la ministre de la Justice serait « chargée de ce dossier », estimant que lorsqu’elle est partie au litige et qu’elle désigne le juge par simple note administrative, cela constitue une procédure contraire à la loi. Elle a affirmé qu’il ne s’agit « ni d’une cour indépendante, ni d’une cour impartiale », évoquant des propos du chef de l’État déclarant : « Celui qui les acquitte est leur complice. »
Le président de la séance a inscrit les déclarations de Me Abbou au dossier et a répondu : « Je suis effectivement désigné par une note, je le sais. Mais il n’entre ni dans mes compétences ni dans mes prérogatives de statuer sur une demande de récusation me concernant. »
Un procès à distance vivement contesté
L’avocat Samir Dilou a pris la parole pour rejeter catégoriquement la tenue du procès à distance, estimant qu’elle ne garantissait « même pas les conditions minimales d’un procès équitable ». Il a dénoncé ce qu’il considérait comme une incohérence dans l’argument sécuritaire avancé pour justifier cette procédure, citant l’exemple de l’accusé Hattab Slama, transféré depuis la prison de Bulla Regia jusqu’à la Mornaguia pour comparaître à distance, tout en affirmant qu’il serait soi-disant impossible d’assurer sa présence au tribunal de Bab Bnet. Il a également relevé que d’autres prévenus, comme Noureddine Bhiri, se présentaient à des audiences dans d’autres dossiers sans que leur présence ne soit jugée dangereuse.
La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, avait défendu avec vigueur le recours aux procès à distance lors de la plénière consacrée, samedi 15 novembre, à l’examen du budget de son département. Elle avait qualifié ce dispositif, mis en place durant la pandémie de 2020, de « grande réussite », en affirmant qu’« aucune plainte » n’avait été formulée depuis son adoption.
La ministre avait précisé qu’elle n’en était pas l’initiatrice, mais qu’il s’agissait d’un mécanisme désormais éprouvé, particulièrement utilisé pour les affaires de terrorisme. Selon elle, les procès à distance garantissaient toutes les conditions logistiques et sécuritaires nécessaires, notamment en ce qui concernait le transport des détenus, qu’elle présentait comme un facteur majeur justifiant le maintien de ce mode de comparution. Elle avait insisté sur le fait que ce dispositif s’inscrivait pleinement dans le respect de la loi et répondait aux exigences de sécurité des institutions.
Les familles des détenus et leur comité de défense avaient, pour leur part, vivement dénoncé la décision d’organiser l’audience d’appel à distance et sans la présence des prévenus, considérant cela comme une atteinte flagrante au droit à un procès équitable. Ils avaient rappelé que le dispositif de visioconférence avait été instauré uniquement pour des raisons sanitaires au moment de la pandémie et qu’il n’avait jamais été justifié par des impératifs de sécurité.
Selon eux, le recours à ce mode de comparution dans cette affaire relevait avant tout d’une volonté politique « d’éloigner les accusés de l’espace public et d’éviter toute véritable confrontation judiciaire ». Les familles avaient qualifié cette démarche de « procès bâillonné » et accusé les autorités de chercher à restreindre toute expression dissidente.
Avril 2025 : un premier verdict rendu dans un climat explosif
Le verdict dans l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État » avait été, rappelons-le, rendu à l’aube du 19 avril 2025, après une nuit entière d’attente. Les peines infligées aux accusés avaient atteint jusqu’à 66 ans de prison. L’affaire concernait une quarantaine de personnes jugées par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme.
Les autorités judiciaires retenaient contre les accusés plusieurs charges graves, parmi lesquelles le complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, l’appartenance à une entente terroriste liée à des actes terroristes, ainsi que des accusations d’attentat visant à modifier la forme du gouvernement ou à pousser les habitants à s’entretuer. S’y ajoutaient des faits de provocation de troubles, de meurtres et de pillages en lien avec des crimes terroristes, ainsi que des atteintes à la sécurité alimentaire et à l’environnement. Pour les accusés en fuite, le tribunal avait ordonné l’exécution immédiate du jugement.
Le verdict était intervenu dans un contexte de vives contestations. Les familles des détenus politiques avaient qualifié la procédure de « mascarade », tandis que le comité de défense avait dénoncé une « parodie de justice ». L’audience du 18 avril, censée être consacrée au débat de fond, s’était tenue en l’absence des accusés et n’avait duré que quelques instants, se résumant à la lecture rapide de quelques lignes avant le départ du tribunal pour délibérer. La défense avait demandé le report de la séance au motif qu’un pourvoi en cassation concernant la décision de la chambre d’accusation était encore en cours. Ces requêtes avaient été rejetées, de même que les demandes répétées d’interroger les accusés ou de présenter les plaidoiries sur le fond.
De nombreuses critiques avaient également visé le déroulement global de la procédure. Des entorses aux principes d’un procès équitable avaient été signalées, telles que l’interdiction faite aux familles, aux journalistes et aux ONG d’accéder à la salle d’audience, l’usage permanent de la visioconférence, la pression exercée sur les avocats ou encore une présence policière particulièrement dissuasive autour du tribunal. Pour le comité de défense, ces dysfonctionnements s’inscrivaient dans une série d’irrégularités remontant aux premières arrestations de février 2023, et les verdicts prononcés auraient été le résultat d’instructions politiques.
M.B.Z