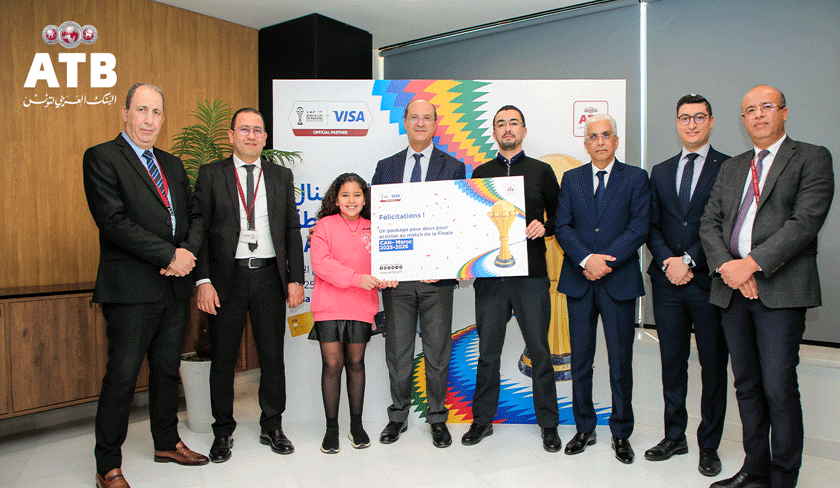Par Mohamed Salah Ben Ammar
Le 14 janvier n’est plus une date. C’est un espoir et une cicatrice. C’est aussi l’aboutissement d’une lutte de plusieurs décennies.
Quinze ans après la révolution, la Tunisie, suite à une décision unilatérale, ne célèbrera plus un élan national mais n’en déplaise à beaucoup elle continue à commémorer, en silence, une promesse, certes inachevée, mais toujours vivante.
Le pays n’est ni mort politiquement, ni vivant démocratiquement. Il est suspendu. Immobilisé dans cet entre-deux douloureux où les nations savent ce qu’elles ont perdu sans encore savoir ce qu’elles veulent devenir.
La révolution n’a pas été écrasée. Elle a été trahie, récupérée. Ceux qui ne l’ont pas faite l’ont utilisée, vidée de son sens, puis retournée contre ceux qui se sont battus des décennies pour la rendre possible. C’est un classique.
La « Nation de la dignité » ne s’est pas effondrée dans le fracas ; elle s’est lentement figée, usée par ses propres contradictions, trahie par ceux qui devaient lui donner forme. Aujourd’hui, le plus grand danger n’est ni le chaos ni la répression brute, mais cette paralysie silencieuse qui hypothèque l’avenir.
Le rêve de 2011 : une brèche refermée
N’en plaise aux esprits chagrins, le 14 janvier 2011, quelque chose d’exceptionnel s’était produit. La peur avait changé de camp. La parole s’était libérée. S’en est suivi un débat, imparfait mais réel, qui a rompu un silence de plusieurs décennies. Une énergie civique rare avait traversé la société tunisienne : associations, médias libres, initiatives locales, pluralisme balbutiant. Pour une génération entière, la Tunisie était devenue la preuve vivante qu’un changement pacifique était possible dans le monde arabe.
Ce rêve n’a pas disparu. Il a été abîmé, dévoyé, parfois cyniquement instrumentalisé. Il survit aujourd’hui à l’état quiescent, enfoui dans la mémoire collective, comme une promesse que l’on n’ose plus formuler à voix haute. Ce n’est pas la société qui a renoncé la première. Ce sont les architectures politiques censées traduire ce rêve en institutions durables qui ont échoué.
La rupture qui s’est refermée sur elle-même
L’arrivée de Kaïs Saïed au pouvoir n’est pas un accident de l’histoire. Elle est le produit d’un immense désenchantement. Rejet des « élites ex nihilo» autoproclammées, post-révolutionnaires, fatigue démocratique, colère sociale, besoin d’ordre : tout était déjà là. Son discours de pureté morale et de rejet du système a rencontré un pays lassé de l’impuissance et de la corruption.
Mais la rupture promise s’est muée en impasse. Depuis 2021, la concentration du pouvoir, la dissolution du Parlement, la Constitution 2022 taillée sur mesure, l’érosion méthodique des contre-pouvoirs et la mise à l’écart de la société civile ont installé un régime de personnalisation extrême. La relative légitimité électorale s’est substituée au débat.
L’autorité est devenue une fin en soi.
Le discours s’est durci, radicalisé : souverainiste mais flirtant dangereusement avec le régime d’un pays voisin, identitaire, nationaliste, panarabiste de façade, admiratif du kadhafisme, souvent xénophobe allant même jusqu’à se vanter auprès des européens d’avoir freiné l’afflux de migrants. Il n’a pas seulement fracturé la société ; il a terni l’image internationale de la Tunisie. Surtout, il a servi de rideau de fumée à l’absence de réponses économiques, sociétale concrètes.
Les opposants ont été judiciarisés, les médias intimidés, les élites et les plus vulnérables transformés en boucs émissaires. Le résultat est brutal : une économie exsangue, une société sous tension permanente, un État affaibli et une démocratie vidée de sa substance.
Une peur du vide politique et institutionnel crée saisit tout observateur objectif de la vie politique en Tunisie, l’avenir s’annonce sombre.
Une crise ancienne, désormais à nu
La Tunisie ne s’est pas perdue en quinze ans. Elle paie en ce moment des fractures plus anciennes, désormais mises à nu :
Une crise identitaire non résolue, incapable de produire un récit national inclusif.
Une crise économique structurelle, marquée par les inégalités territoriales, le chômage des diplômés et l’économie informelle.
Une crise politique profonde, où les institutions survivent sans légitimité réelle, et où le débat public est étouffé.
Ces failles internes sont aggravées par un environnement régional instable et une économie mondiale sous pression. La détresse nourrit la demande d’ordre. L’ordre autoritaire, sans vision productive, aggrave la stagnation. Le pays tourne en rond.
Ce qui n’a pas été vaincu
Et pourtant, tout n’a pas été perdu.
Ce qui résiste encore, c’est la société. Une culture de la liberté profondément ancrée. Une parole critique déplacée, fragmentée, parfois prudente, mais jamais totalement éteinte. Dans les réseaux sociaux, l’art, l’entraide locale, l’engagement associatif, la Tunisie continue de respirer.
Là où l’État recule, la société s’organise. Ce capital immatériel — fragile mais réel — est le dernier rempart contre l’effondrement moral. Il maintient ouverte la possibilité d’un autre futur.
L’État immobile
L’État tunisien n’est pas un complot permanent et généralisé. Il est fatigué.
Des pratiques inacceptables ont survécu à la révolution dans la justice, la police, les douanes, l’administration, l’éducation, la santé, le sport, bref dans tout ce qui touche à la vie des citoyens. Cet appareil a assuré la pérennité de l’Etat à un moment donné mais en confondant stabilité et immobilisme, il est devenu incapable de porter le changement.
Commémorer pour choisir
« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. » a écrit René Char.
La Tunisie est à un point de bascule. Le rêve du 14 janvier 2011 a été avorté. Mais il n’est pas pour autant enterré.
Certes il ne doit pas être une commémoration de plus, vidée de sens. Il doit être un moment de vérité. Rien ne viendra d’un homme prétendument providentiel. Rien ne viendra de l’extérieur. Rien ne se fera sans un travail de fond, sans une remise en question, sans une lucidité assumée, sans débat national apaisé, sans courage collectif.
Croire aux miracles est forme d’immaturité et si une aube devait encore naître, elle viendrait que de nous en tant communauté nationale qui a un projet. Elle viendrait d’un choix commun : reconstruire le débat démocratique, refonder des institutions au service des citoyens, accepter des réformes difficiles mais justes, et renouer avec l’esprit originel de dignité et de responsabilité.
L’alternative n’est pas entre l’ordre et le chaos. Elle est entre la résignation et la volonté de reprendre en main un destin commun. Et cette fois, personne ne le fera à notre place.
BIO EXPRESS
Mohamed Salah Ben Ammar est un médecin et universitaire tunisien, ancien ministre de la Santé en 2014
Cet article est une tribune, rédigée par un auteur extérieur au journal et dont le point de vue n’engage pas la rédaction.